FOMO n’est pas un faux mot.
Il s’agit de l’acronyme pour Fear Of Missing Out.
C’est un terme qui a gagné en popularité durant le premier confinement pour refléter l’étrange comportement d’une partie de la population. Dont le mien. En effet, comme beaucoup, j’avais notamment peur de « rater » mon isolement si je n’utilisais pas ce temps limité à bon escient. Une crainte d’autant plus renforcée lorsque l’on a une forte tendance à la procrastination.
Pour la plupart, cela s’est traduit par une hyperconnexion afin d’être au courant du dernier événement en date pour profiter de la moindre interaction sociale. Pour moi, cela concerner aussi des sorties, mais des sorties cinéma, de comics, de jeux vidéo… Tous ces supports recèlent une quantité astronomique d’oeuvres que je m’efforce de relayer ici, à travers ce webzine.
D’où son nom.
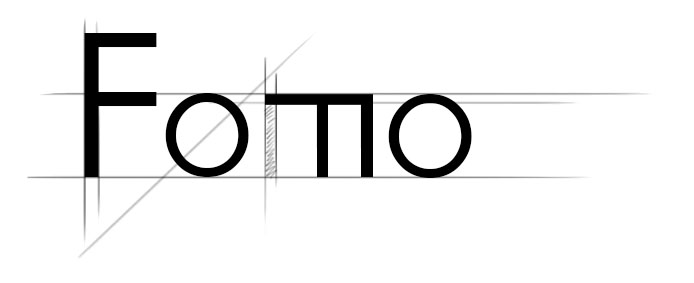
C’est là un moyen pour moi d’être raccord avec l’actualité, mais surtout avec ma consommation assez conséquente en la matière. Ce regroupement sous diverses catégories est donc la solution que j’ai trouvée, puisque je suis dans l’impossibilité de faire des articles pour chaque oeuvre. Quand bien même, chaque contenu ne mérite pas une publication. Par contre, d’autres oui, et c’est l’objet du disclaimer qui suit.
Disclaimer:
Certaines des critiques ci-dessous sont amenées à se développer dans des articles à part entière. Tout dépend de l’intérêt que je porte à l’oeuvre en question. Cela peut être par envie de donner à une découverte plus de visibilité, ou d’avoir à coeur d’analyser dans le détail un coup de coeur. Si l’une ou l’autre de ces conditions est au rendez-vous et que je dispose d’un point de vue qui n’a pas encore été abordé ailleurs, alors je me réserve le droit de lui consacrer une future publication pour revenir en long et en large sur le sujet.Il est alors possible que vous ayez une impression de déjà vu à la lecture. Et pour cause, je vois les critiques qui vont suivre comme de potentielles ébauches.
Mais ne vous y trompez pas, ici ça spoile à balles réelles alors gare aux révélations!
Si malgré cet avertissement vous ressentez le besoin de parcourir ce qui va suivre, alors c’est que vous êtes potentiellement atteint par le syndrome FOMO.
Bienvenue au club.
Dans le club de ceux qui préfèrent perdre quelques minutes à lire une critique, plutôt que de s’investir des heures durant dans une oeuvre qui pourrait potentiellement leur déplaire.
CINÉMA
John Wick: chapitre 4 / Creed 3: la relève de Rocky Balboa
Au regard de ses multiples bonnes actions, Keanu Reeves a tout d’un saint. Et il a même failli avoir un jour à sa gloire le 21 mai 2021. Une date à laquelle étaient censés sortir simultanément les quatrièmes opus de Matrix et John Wick. Pilule bleue ou pilule rouge? Un choix cornélien que les spectateurs n’ont pas eu à faire en salle en guise de première séance. En cause, la crise du Covid. Le Keanu Day n’a donc pas eu lieu, et les deux longs-métrages ont été repoussés. Maintenant qu’ils sont sortis, il est possible de déterminer quel film aurait pu avoir les faveurs du public.

Même si je n’aurais pas parié dessus, John Wick: chapitre 4 en serait largement sorti victorieux. Et c’est un grand fan de Matrix qui parle. D’ailleurs, la réalisation de cette ressurection aurait dû être confiée à Chad Stahelski vu le piètre résultat. Lui qui a été la doublure cascade de Keanu Reeves, pour les besoins de la trilogie de Larry et Andy Wachowski, a depuis fait ses armes en tant que réalisateur. Et ce n’est pas peu dire puisqu’il a gravi les échelons en étant réalisateur de seconde équipe, affiliée aux scènes d’action, jusqu’à se voir confier la co-réalisation du premier John Wick aux côtés de David Leitch.
Depuis, ce dernier a fait cavalier seul tandis que Stahelski s’est approprié la franchise. Ainsi, on peut voir le film original comme une sorte de prologue à une trilogie qui aura vu émerger un véritable cinéaste. Et modeste qui plus est. En effet, à la question d’un cinquième opus, le réalisateur répond qu’il doit d’abord s’investir dans d’autres projets afin de devenir un meilleur conteur pour la franchise. Une réponse curieuse au regard de la fin funeste de ce volet, mais surtout du niveau d’excellence qu’il vient d’atteindre. Jamais un film d’action n’aura été aussi abouti visuellement.
Techniquement irréprochable, Chad Stahelski propose des séquences parfaitement lisibles. Le montage permet de savourer chaque affrontement que ce soit mano à mano, à l’épée, au nunchaku, arme au poing, en voiture… Aussi étonnant que cela puisse paraitre, malgré la débauche de cascades, le film n’use jamais d’une vulgaire explosion pour donner dans le spectaculaire. Une prouesse de nos jours. Et cette excellente mise en scène atteint des sommets, littéralement, lors d’un gunfight filmé en plan séquence en vue zénithal dans un appartement parisien.

À ce propos, une fois encore on se retrouve dans le cas de figure des Américains qui filment mieux la France que les Français eux-mêmes. Ainsi, le périple de John Wick se transforme en visite guidée de la capitale, avec la tour Eiffel comme base d’opération sous couvert de station de radio. Depuis cet édifice, les ondes se propagent afin d’offrir une musique intradiégétique qui colle parfaitement aux scènes d’action. Mais avant d’en arriver là, John ira chercher de l’aide chez un vieil ami à Osaka. Une destination qui permet de voir à quel point l’esthétique du film a été travaillée.
Ce Continental japonais est l’occasion d’en mettre plein les yeux. C’est carrément une fête des Lumières qui sert de cadre aux personnages. Les néons donnent alors l’impression d’être dans un film de Nicolas Winding Refn avec cette atmosphère à la fois sombre et lumineuse. Puis, l’histoire fait une escale à Berlin pour nous offrir une scène de tension mémorable autour d’une table. Une tension que l’on doit essentiellement au jeu de Scott Adkins, grimé en mafieux obèse, encore plus charismatique que le Pingouin de Collin Farell dans The Batman.

Face à lui, John Wick, bien sûr, mais aussi Caine et monsieur Personne. Respectivement incarnés par Donnie Yen et Shamier Anderson, ces deux nouveaux personnages participent à l’intérêt de ce quatrième opus. Le premier est de nouveau aveugle après son rôle dans Star Wars: Rogue one, mais reste un artiste martial hors pair. Son handicap laisse alors à penser qu’il pourrait aisément battre John Wick s’il était en pleine possession de ses capacités. Dans un tout autre style, plus urbain, monsieur Personne rappelle Sofia dans Parabellum, toujours accompagné de son chien.
J’ai beaucoup aimé son arc narratif, même si j’aurais aimé que ses intentions de départ ne cessent de prendre de l’ampleur. En effet, ce tueur s’applique à tuer les opposants au héros afin de faire grimper les enchères autour de cette prime. Une idée vraiment intéressante que j’aurais aimé voir mener à bien. Plutôt que de le voir s’allier au marquis de Gramont. Interprété par Bill Skarsgard, terrifiant clown dans Ça, l’acteur offre un antagoniste que l’on adore détester. Tous ces personnages s’affrontent autant à coup de poing que de punchlines bien senties. Mention spéciale à Laurence Fishburne qui déclame un passage de La divine comédie en ouverture.

Une référence loin d’être cohérente avec un film d’action, mais totalement raccord avec l’ambiance de la saga. On retrouve donc pas mal de références à l’art, des tableaux… Et même une balade en bateau évoquant Charon, le passeur d’âme vers le royaume des morts. En somme, tout ce qui donne à la franchise son identité, à cheval entre violence et raffinement. Un état d’esprit qu’incarne Winston, dont l’importance ne cesse de prendre de l’ampleur, film après film. Et si celui-ci est le plus long avec 2h50 au compteur, c’est bien parce qu’il laisse de la place au développement de ces seconds rôles.
De fait, cette durée hors norme n’est pas seulement justifiée par la surenchère qu’implique une débauche d’action, mais surtout par les personnages. Il y a une véritable dualité entre eux, un passif, un code de l’honneur et des règles à respecter. La mythologie autour de La grande table est d’ailleurs plus présente que jamais, et se révèle toujours aussi passionnante à suivre. On y découvre d’entrée de jeu que le Grand maitre a été remplacé, et qu’il le sera à nouveau suite à sa rencontre avec John Wick. Par contre, ce dernier est irremplaçable.

Pourtant, contre toute attente, le scénario offre bel et bien une porte de sortie à son héros. Un choc que ne viendra pas atténuer la scène post-générique à travers un éventuel sursaut, préférant se centrer sur d’autres personnages. En cela, ce chapitre 4 offre une bonne fin au personnage, car inattendu. Mais surtout méritée. Maintenant qu’il en a terminé avec la saga en tant que tête d’affiche, peut-être que Keanu Reeves restera investit dans les coulisses. Pourquoi pas derrière la caméra pour étendre cet univers à travers des spin-offs à l’image de Ballerina dans lequel il fera une dernière apparition.
En tout cas, Michael B. Jordan n’aura pas attendu que son personnage soit hors jeu pour passer derrière la caméra avec Creed 3: la relève de Rocky Balboa. Un défi avec tout ce que cela implique pour un premier film, mais aussi en tant que troisième opus chargé de conclure une trilogie. À cela, il faut également ajouter la difficulté de se renouveler dans un genre où tout a déjà été fait en ce qui concerne la boxe. Malgré tout, cela n’a rien d’une lubie dans la carrière de l’acteur. À l’image d’Adonis suivant les traces de Rocky, Michael B. Jordan marche dans les pas de Stallone qui avait mis en scène les volets 2, 3, 4 et Rocky Balboa.
Mais en raison de problèmes de droit, le célèbre boxeur ne sera pas présent au casting. Une absence qui peut sembler étonnante, sans pour autant être regrettable. En effet, l’arc narratif de Rocky avait été bouclé dans Creed 2, où on le voyait retourner auprès de son fils. Son éloignement est d’autant plus logique qu’ici Adonis a pris sa place en tant que figure d’autorité. On franchit donc un cap supplémentaire dans l’émancipation de la franchise-mère qu’est Rocky.

Dans le premier, Adonis avait quelque chose à prouver par rapport à la légende qu’était son paternel, et dans le deuxième, le retour d’Ivan Drago ne faisait que l’enfermer un peu plus dans son ombre. Avec ce troisième opus, il va enfin s’affirmer sans regarder en arrière. C’est plutôt le passé qui va se rappeler à lui en la personne de Damian. À mi-chemin entre l’ami d’enfance et le demi-frère, ce personnage va revenir dans la vie d’Adonis après un séjour en prison. Une peine à laquelle il n’est pas étranger et c’est pour cette raison qu’il va se sentir redevable.
Adonis va donc user de son influence dans le milieu pour que son ami puisse remettre les pieds sur un ring. Mais si Creed est rongé par la culpabilité, Damian est quant à lui guidé par la rancoeur. S’il a passé des années derrière les barreaux, c’est à cause d’une erreur de jeunesse. Mais pas la sienne. Il n’a fait qu’endosser pour une faute commise par Adonis et c’est en véritable conquérant qu’il se révèle peu à peu. Avec ce lourd passif, il y a une véritable tension qui s’installe entre les adversaires, devenus frères ennemis.

Leur combat n’en devient alors que plus personnel, chacun affrontant la personne qu’il aurait pu être. Ainsi, Damian se bat contre le champion qu’il était destiné à devenir, avec la gloire et la richesse qui vont avec. Quant à Adonis, c’est contre ce délinquant qu’il aurait pu devenir qu’il se déchaine, celui qui aurait pu finir en prison s’il avait assumé ses responsabilités. Dans le genre, Jonathan Majors fait des merveilles. Le comédien offre le portrait d’une revanche sur la vie, tout en voulant rattraper le temps perdu. Ou qu’Adonis lui a volé.
Difficile de prendre parti tant Damian est tout à fait légitime. En fin de compte, cet adversaire est aussi complexe que celui qu’incarnait Michael B. Jordan dans Black Panther. C’est-à-dire un personnage désireux de récupérer la reconnaissance qui lui est due. Pour Killmonger, c’était son statut de roi du Wakanda, pour Damian, c’est son titre de roi du ring. Mais pour que cela se concrétise, Adonis doit mettre sa vie de famille de côté pour enfiler ses gants. Il y a d’ailleurs un côté The Dark Knight Returns dans ce personnage qui sort de sa retraite pour un dernier tour de piste.
Dès lors, on assiste à l’habituelle phase d’entrainement des deux côtés. C’est là qu’un déséquilibre en la faveur d’Adonis se fait ressentir. En effet, le fils de Drago, Viktor, fait son retour en tant que punching-ball humain. Un retour inattendu, mais bienvenu, qui vient enterrer la hache de guerre entre les deux boxeurs. Mais c’est surtout l’appui du coach de Creed qui rend le combat final plus bancal. Celui qui assiste Damian semble alors sortir de nulle part, faute d’avoir été développé auparavant. On ne croit pas en ses encouragements, pas plus qu’aux chances de son poulain de l’emporter.

Pour plus d’égalité, il aurait été appréciable de voir son entrainement en prison. Un univers carcéral où l’on se bat plus pour sa survie que pour un prix. Un environnement plus rude, apte à forger la machine à tuer qu’est devenu Damian. À défaut d’avoir été invité dans la cellule de ce détenu, celle-ci s’invitera lors de cette rencontre au sommet. C’est là que Michael B. Jordan innovera dans la mise en scène en faisant appel à une forme d’onirisme. Plongé dans un état second, la foule disparait et des barreaux de prison font office de cordes pour le ring.
L’apprenti réalisateur va aussi puiser du côté de la japanimation avec certains mouvements de caméra. La musique entrainante participe également à rendre les rounds plus rythmés. Mais Michael B. Jordan excelle aussi lors de moments plus intimistes. C’est notamment le cas dans les dernières scènes où les deux adversaires ne se font plus face, mais sont côte à côte. Leur disposition laisse alors penser à un confessionnal dans les vestiaires, comme si chacun voulait expier ses fautes passées.

Une composition bien pensée, qui vient en opposition à un autre cadrage, toujours dans les coulisses, mais cette fois-ci avant un match. Un plan annonciateur de la discorde entre les deux combattants. Ou l’illustration parfaite de l’expression parler à un mur. Mais comme chacun le sait, les coups pleuvent lorsque l’on est à court de paroles. Et certaines répliques sont plus puissantes qu’un seul coup:
-Relève-toi tout seul pour une fois, que tu saches ce que ça fait.
Sans Rocky pour l’aider, Adonis Creed a d’autant plus de mérite d’avoir réussir à gravir la montagne de muscles qu’est Damian.
COURT-MÉTRAGE
The black hole
Toutes les histoires se terminent par un point final. Au contraire, et bien que très courte, celle de The black hole commence par un point. Un gros point noir sur une feuille blanche dans ce qui a tout l’air d’être une défaillance de la photocopieuse. Son utilisateur n’est autre qu’un employé de bureau que l’on croirait échapper de Fight Club. Tout comme Edward Norton, il n’en reste pas moins prisonnier de son travail, jusqu’à ce qu’il comprenne les possibilités offertes par cette simple anomalie. En effet, ce trou noir n’est pas seulement une tache d’encre, c’est surtout un portail.
Un pitch digne de Twilight Zone qui pourrait tenir sur la fameuse feuille, tout comme le script pourrait se résumer à ce simple point sur ce même support. D’une manière plus imagée on peut y voir là une mise en abime de l’exemple de la feuille que l’on repli sur elle-même, avant de la transpercer d’un crayon, pour faire comprendre à quelqu’un le concept de trou de ver. Là, c’est la même chose avec ce feuillet qui permet de passer certains obstacles à l’aide de cette matière noire. À partir de ce point de départ, littéralement, le duo derrière ce court-métrage confronte leur personnage à la tentation.
Nul besoin de dialogues pour le raisonner, le protagoniste cède assez vite à ses pulsions pour explorer son lieu de travail à travers ce prisme. Impossible de ne pas penser à Portal, mais ce qui impressionne surtout, c’est d’avoir réussi à instaurer une ambiance en si peu de temps. En moins, de trois minutes, soit le temps d’une bande-annonce, Phil Sampson et Olly Williams font preuve de talent pour captiver dès les premières secondes. C’est tellement captivant que cela aurait pu être la scène d’introduction pré-générique d’un épisode de Fringe.
FILMS
Y a-t-il un pilote dans l’avion? / Y a-t-il enfin un pilote dans l’avion? / Les Tortues Ninja / Les Tortues Ninja 2: les héros sont de retour / Les Tortues Ninja 3: retour au pays des samouraïs / Batman contre le fantôme masqué / Batman et Mr Freeze: subzéro / Power Rangers
L’enfance est une période où j’adore trouver refuge. Et avec laquelle je suis très indulgent aussi. Notamment mes gouts concernant certaines oeuvres cinématographiques. De temps à autre, j’aime donc revenir sur des films qui ont fait de moi celui que je suis aujourd’hui, mais toujours avec ce même regard d’enfant. Force est de constater que certaines productions ont mieux vieilli que d’autres. Ces longs-métrages peuvent prêter à sourire, mais ce fut surtout l’éclat de rire devant Y a-t-il un pilote dans l’avion?.
Une question par laquelle il est difficile de répondre par l’affirmative tant les prétendants à ce poste sont loin d’être des as du pilotage. Pourtant, il va bien falloir que quelqu’un se dévoue lorsqu’une intoxication alimentaire se répand à bord de l’appareil. Tous les regards se dirigent donc vers Ted, un ancien pilote de chasse, à bord pour reconquérir son amour, hôtesse de l’air sur ce vol. Il faut dire que Ted est bien pire que l’épidémie qui affecte les passagers, ses voisins ayant mis fin à leur jour après l’avoir écouté raconter ses déboires amoureux.

Pour quelqu’un qui s’y prend comme un manche, le voir aux commandes d’un avion est loin d’être rassurant. Mais c’est toujours mieux que le pilote automatique en forme de poupée gonflable. Qu’il faut bien sûr regonfler à l’entre-jambes. Des gags qui sont loin de tomber à plat et qui me font toujours autant rire des années plus tard. Et je me demande d’ailleurs pourquoi puisqu’à l’époque, je n’étais pas en âge de comprendre certaines blagues. Encore moins d’avoir vu certains classiques qui y sont parodiés. Cela ne m’a pas empêché d’adorer ce film réalisé par le collectif connu sous le nom de ZAZ.
Derrière ces initiales se cachent les frères David et Jerry Zucker, Jim Abrahams. Un trio de réalisateurs, scénaristes et producteurs qui sont passés maitres dans l’art de la comédie. Plus précisément dans le fait de caser des choses insolites en arrière plan. Un humour absurde auquel je suis totalement réceptif et que j’avais adoré dans le diptyque Hot Shots. Toutefois, le trio ne sera pas derrière la suite Y a-t-il enfin un pilote dans l’avion?. Pourtant, leur savoir-faire est tout à fait palpable. J’ai même trouvé ce second opus, écrit et réalisé par Ken Finkleman, encore meilleur que l’original.

Il a su s’approprier les codes tout en allant dans la surenchère. Mention spéciale pour la séquence avec William Shatner dans une parodie de son rôle de Kirk dans Star Trek: hilarant! Mais ces deux films ne seraient rien sans le talent pour la comédie de Peter Graves, Leslie Nielsen ou encore Lloyd Bridges. Ils savent garder leur sérieux en toute circonstance pour débiter des répliques hors sujet, mais toujours à mourir de rire. Mais outre cette question fatidique de savoir s’il y a un pilote dans l’avion, ce revisionnage m’a surtout fait m’interroger sur ces sketchs: pourraient-ils être refaits de nos jours?
À plusieurs reprises, je me suis surpris à émettre un doute quant à la réaction que ces blagues pourraient susciter face au public actuel. Tout le monde en prend pour son grade, que ce soit les hommes, les femmes, leur sexualité, les religions… Personne n’est épargné. À une époque où il est de plus en plus difficile de rire de tout, et où la susceptibilité est de mise, je suis bien content de pouvoir compter sur ces classiques pour réveiller mes zygomatiques. Cela ne fait pas pour autant de moi quelqu’un qui se moque de tout, juste avec suffisamment d’autodérision pour passer outre.

Et il faut en avoir pour se replonger dans le premier opus des Tortues Ninja, en version québécoise. Ainsi, le clan des Foot devient le clan de la savate et Shredder est renommé en maitre déchiqueteur. Faute d’un doublage français, la nostalgie a eu du mal à opérer. Mais la bonne piste audio était au rendez-vous pour la suite qu’est Tortues Ninja 2: les héros sont de retour, dont le sous-titre original est Secret of the Ooze. Derrière cette appellation se cache la substance radioactive qui a transformé les tortues en bipède.
Bien évidemment, Shredder va faire ses propres expériences sur d’autres animaux afin de se venger du quatuor et de leur maitre. Outre ces expérimentations foireuses, la némésis des tortues reste le meilleur candidat pour tester cette matière dangereuse. Ainsi, cette séquelle vaut surtout pour son Super Shredder complètement démesuré qui vient clôturer ce film. La trilogie, quant à elle, sera clôturée par Les Tortues Ninja 3: retour au pays des samouraïs. Clairement le moins réussit des trois, mais qui a le mérite de transporter les héros dans un autre environnement.

Exit donc le New-York poisseux avec ses bouches d’égout fumantes comme je les aime, et place au Japon. Plus précisément, le japon du 18ème siècle. Ce récit implique donc du voyage dans le temps pour un film qui parait encore plus daté que ses prédécesseurs. Cela se ressent surtout dans les prothèses qui ont l’air d’avoir été moins travaillées, moins détaillées. Celles du premier long-métrage étaient vraiment bluffantes, en plus de donner une sacrée marge de manoeuvre dans les mouvements et les chorégraphies de combat.
Des effets techniques, à base d’animatroniques, qui n’ont pas vieilli et qui rivalisent sans peine avec les CGI du reboot de 2014. Cette qualité a donc été revue à la baisse, et c’est particulièrement visible dans ce troisième volet. Dès lors, il est difficile de croire en l’existence de ces tortues mutantes, et par extension, de s’investir dans leur histoire. Une histoire qui débute pourtant par un plan d’ouverture incroyable avec un soleil sur fond rouge du plus bel effet, tandis qu’une chevauchée s’avance au premier plan. Le reste de la réalisation n’atteindra jamais ce niveau.
Le retour du personnage de Casey Jones, après son absence du deuxième volet, dans un double rôle ne rehaussera pas plus l’intérêt. Une conclusion décevante donc, mais qui aurait pu être bien pire en version québécoise, comme ce fut le cas sur l’édition DVD du premier opus. Une piste audio à laquelle j’ai échappé sur mon édition de Batman contre le fantôme masqué suite au mécontentement de nombreux fans. C’était quelque chose que je redoutais, ne sachant pas sur quelle version j’allais tomber lors de mon achat.

Je fus donc soulagé de retrouver le doubleur Richard Darbois pour incarner le chevalier noir. Une voix qui a bercé mon enfance pour un film d’animation qui a redéfini les origines de Batman. On découvre ainsi, à travers des flashbacks, un Bruce Wayne en plein apprentissage. Son côté torturé est également mis à l’honneur avec le serment qu’il a fait à ses parents de dédier sa vie à la lutte contre le crime, et la possibilité d’une vie bien rangée avec Andréa Beaumont. Un dilemme que cette dernière va choisir à sa place en se révélant être le fantôme masqué du titre.
Un récit tragique qui s’inscrit dans la continuité de la série animée, et qui donnera naissance à un second film d’animation: Batman et Mr. Freeze: Subzero. Au cas où la mention de l’ennemi n’était pas assez explicite, le sous-titre indique clairement que cette aventure sera placée sous des températures glaciales. On pourrait en dire de même concernant le rendu visuel de certaines séquences qui font usage de la 3D. Des expérimentations que l’on avait déjà pu voir dans le précédent film, mais qui ici rendent l’ensemble trop froid. Presque sans âme.

Toutefois, même si ce film m’a replongé en enfance, loin de mes problèmes d’adulte, son scénario reste terriblement d’actualité avec le réchauffement climatique au coeur de l’intrigue. Comme quoi, c’était déjà quelque chose de préoccupant à l’époque. Et une preuve supplémentaire que les dessins animés peuvent éduquer les plus jeunes sur des sujets assez anxiogènes. Du moment que Batman est là pour sauver la mise, tout est possible. En tout cas, cette thématique permet de développer le personnage de Mr. Freeze, lui qui avait été brillamment réinventé dans la série.
Ici, on le voit durant une bonne partie dans son environnement naturel. C’est-à-dire sur la banquise. Une excellente idée qui permet au personnage d’évoluer sans sa célèbre combinaison réfrigérante. On le retrouve ainsi plus vulnérable, mais aussi plus fort d’une certaine manière, puisqu’à son avantage. Ces éléments rendent cette aventure sympathique à suivre, et donnent envie de se replonger dans la série animée. J’ai eu la même sensation avec Power Rangers vis-à-vis de la série télé. Ce film s’inscrit lui aussi dans la même continuité, même s’il n’est pas nécessaire d’avoir vu un seul épisode pour en comprendre les tenants et aboutissants.

D’entrée de jeu, un texte déroulant se charge de faire le travail en rappelant qui sont les Power Rangers, pour ensuite mieux rentrer dans le vif du sujet. En cela, ce long-métrage pourrait être résumé à un épisode à rallonge, puisqu’il en conserve la structure typique, mais il parvient tout de même à instaurer une dimension cinématographique à son récit. Ceci se fait par l’intermédiaire de scènes de nuit qui rendent moins ridicules les costumes, customisés pour l’occasion. Un détour sur une planète lointaine viendra également donner un côté Histoire sans fin aux rangers dans leur quête pour retrouver leurs pouvoirs.
Des facultés qui sont bien sûr liées au combat, bruitages à l’appui pour accentuer chaque mouvement, mais aussi aux fameux Zords. Ces robots géants en image de synthèse sont loin d’avoir un bon rendu, mais l’intention est là. Tout comme l’émerveillement était au rendez-vous. Pour chacun de ces films, il aura suffi d’appuyer sur le bouton play pour avoir les yeux qui pétilles. Pour revoir ces productions avec mes yeux d’enfant, la pellicule usée en moins à cause de mes nombreux revisionnages. Car oui, malgré l’obsolescence de ce format, je fais partie de la génération magnétoscope, la première à avoir pu revisionner des films plus d’une fois. Et je ne suis pas près de m’arrêter.
COMICS
Avengers Arena tome 1: alliés mortels / Avengers Arena tome 2: boss de fin
La dernière fois que l’industrie des comics s’est approprié un concept fort, cela a donné Gotham Academy. En somme, le croisement entre l’univers de Batman et celui d’Harry Potter. Autant dire que ce n’est pas parce que j’aime ces deux licences que le mélange était à mon gout. Au contraire. Ce mix pouvait fonctionner en apparence, mais il y avait un je-ne-sais-quoi d’incompatible. Je me suis alors mis à imaginer le chemin inverse avec un chevalier noir évoluant dans les couloirs de Poudlard. Cette association contre nature m’a alors conforté dans l’idée que ces deux franchises n’étaient pas forcément faites pour se rencontrer.
De son côté, Marvel a un peu mieux réussi cet amalgame avec Strange Academy. Pour autant, je n’étais pas forcément confiant envers La maison des idées pour la découverte de Avengers Arena tome 1 et 2. Cette fois-ci, ce n’est pas l’univers du sorcier à lunettes qui est à l’honneur, mais celui de Battle Royale. Ou Hunger Games, selon les références que l’on a, qui visiblement sont celles du méchant puisque ce dernier avouera qu’il a eu cette idée en lisant un roman pour adolescent. L’ennemi en question est donc Arcade, un adversaire récurrent des X-men.

Et vu le nombre de mutants qui prennent part à cette histoire, il est étonnant de les voir réunis sous la bannière des Avengers. De plus, le cadre d’une école comme celle de Charles Xavier était bien plus approprié pour évoquer une chasse à l’homme digne de Battle Royale. En effet, ce film de Kinji Fukasaku, lui-même une adaptation d’un roman de Koshun Takami, voit une classe de terminale choisie au hasard pour participer à une tuerie dont ils sont les cibles. En l’absence de contexte scolaire, seul le concept de traque sera repris.
À la fois proie et chasseur, cette galerie de personnages va se courir après pour satisfaire les envies de divertissement d’Arcade. Et ce fut bien le seul. Je ne doute pas que cet antagoniste ait dû s’amuser à planifier ces pièges, mais cet enthousiasme est loin d’être communicatif. Un ennui que l’on peut imputer à un roster de personnages ne figurant pas parmi les plus intéressants pour se livrer à ce genre d’épreuve. Ce sont principalement des héros de seconde zone, et la zone dans laquelle ils évoluent l’est tout autant.
Arcade oblige, c’est Murderworld qui sert de terrain de jeu. C’est loin d’être aussi attrayant que Battleworld, mais à choisir il y avait d’autres lieux emblématiques de l’univers Marvel pour isoler des personnages. Je pense notamment à la Terre sauvage et ses dinosaures. Mais peu importe la faune et la flore, les protagonistes sont pareils à des meubles dans un décor. Les flashbacks en début de chapitre, ou le point de vue extérieur des adultes qui s’inquiètent face à leur disparition dans le tome 2, ne changent rien à leur développement.

La mise en avant de personnages secondaires aurait pu être tout à fait louable si le scénariste Dennis Hopeless était allé au bout de son pitch. Et à faire honneur à son patronyme. À savoir, un match à mort avec un seul vainqueur. Quitte à ne pas jouer le jeu du sacrifice, mettre des figures emblématiques aurait donné un récit bien plus passionnant à suivre. Quand bien même, personne ne reste jamais mort bien longtemps dans le monde des comics. Chez DC Comics, Jason Todd en sait quelque chose et sa disparition à la fin des années 80 aurait pu inspirer Marvel.
Il y avait de quoi créer l’événement en faisant une mise en abime du show d’Arcade en demandant aux lecteurs de voter pour la survie de leur favori. Faute de mieux, il faudra se contenter d’une couverture reprenant le logo de Battle Royale. Une publicité bien mensongère au regard du contenu, et une tentative de plus qui n’aura pas exploité totalement son concept. Harry Potter, Battle Royale: des licences qui ont tenté de se mêler à celles des comics, mais qui auraient bien plus à gagner à se rencontrer. Un deathmatch avec des apprentis sorciers? Voilà qui m’intrigue bien plus.
SÉRIES
Dragon Ball saison 1 à 7
De ma passion pour l’oeuvre d’Akira Toriyama, il ne me restait que le générique entêtant du club Dorothée. J’en ai passé des matinées devant ce programme, cependant j’étais loin d’en avoir fait le tour. Et ce malgré les multiples rediffusions, dans l’ordre et dans le désordre. Pourtant, le refrain de la chanson interprétée par Ariane Carletti avait été plutôt clair en insistant bien sur le Z sous la forme d’un écho. Dragon Ball n’était pas une abréviation, à une lettre près, de Dragon Ball Z, mais bien l’histoire par laquelle tout a commencé.
Ainsi, lorsque j’ai entrepris le revisionnage de l’intégrale, j’ai dû repasser par cette première partie que j’affectionne moins. J’en sais quelque chose pour avoir parcouru quelques manga mettant en scène la jeunesse de Son Goku. Le voir enfin en animé n’a pas changé grand-chose à mon ressenti. En cause, une trop grande place laissée à la comédie. Même si j’étais typiquement le public visé à l’époque, je n’ai jamais vraiment accroché à cet aspect bon enfant. Et encore moins une fois devenu adulte. À cela, et malgré une belle réalisation, il faut ajouter des dessins trop enfantins.
Un visuel d’autant plus appuyé par les bruitages qui sont dans cet état d’esprit. Difficile donc de se remettre dans le contexte de l’époque pour apprécier cette entrée en matière dans la mythologie des Super Saïyans. Une introduction à cet univers de tout de même 153 épisodes. Bien entendu, et même s’il y a un grand nombre d’épisodes inutiles, ceux-ci sont répartis en différent arc narratif. Et dès le pilote, j’ai retrouvé tous les éléments fondateurs de la série: la rencontre de Son Goku avec Bulma, la mention des dragon balls, ainsi que la légende du dragon qui permet d’exaucer les voeux.

À partir de là, le récit s’articule autour de la quête des fameuses boules de cristal avec la récupération de divers alliés en chemin. Et bien sûr, des ennemis. En cela, le structure suit le même développement qu’une quête annexe de jeu vidéo avec la recherche d’un McGuffin, à savoir ici une dragon ball, puis du passage d’une épreuve afin de l’obtenir. Ce cycle se répète ainsi de suite jusqu’à la septième boule. Une fois réunies et utilisées, elles se dispersent de nouveau pendant un an, période durant laquelle Son Goku va débuter un entrainement.
Ces 13 premiers épisodes forment donc un arc narratif complet qui culminera avec la transformation du héros en gorille garou. La saison 2 aura alors pour objectif de canaliser ce côté bestial. Son Goku devra alors se mesurer à bien des adversaires lors du 21ème Tenkaichi Budokai. Un tournoi d’art martiaux qui interviendra une saison sur deux et qui clôturera la dernière. Entre-temps, Goku devra affronter l’armée du ruban rouge, dans laquelle se trouve une caricature de Schwarzy en mode Terminator.

D’autres figures bien connues viendront également faire leur apparition. C’est notamment le cas des Universal Monsters au début de la quatrième saison. En effet, la dernière boule de cristal étant manquante à l’appel, l’équipe décide de faire appel à une voyante afin de découvrir sa position. Cette information ne leur sera révélée que si Son Goku accepte d’affronter Dracula, l’homme invisible, la momie et le diable. On est loin du folklore japonais ce qui fait que ce bestiaire légendaire dénote dans le récit.
Aucun d’entre eux ne bénéficiera d’une réinterprétation pour s’adapter à ce monde où l’on peut croiser des combattants, un nuage super sonique, ou encore des dinosaures, notamment des ptérodactyles. Seul un monstre bénéficiera d’un traitement inédit: le loup-garou. Ou plutôt l’homme-garou. En effet, le concept de métamorphose est ici inversé avec un loup qui est capable de se transformer en humain les nuits de pleine lune. Mais cette réinvention n’enlève rien à la répétitivité de la série.

Une redondance qui rend le visionnage ennuyant une fois que l’on en prend conscience. L’alternance entre la libération d’un peuple de l’oppression et les différents tournois d’art martiaux fait que l’on perd en intérêt au fur et à mesure. Et c’est sans compter sur les titres des épisodes qui sont toujours plus explicites sur leur contenu. De véritables spoilers ambulants. Tout ceci fait qu’il est légitime de se demander si le format vidéoludique n’était pas plus adapté pour narrer cette épopée.
Il n’y a qu’à voir la recherche des dragon balls qui pioche dans le RPG, ou les tournois qui sont suffisamment explicites pour prendre la forme d’un jeu de combat. Pour ce qui est de l’ascension dans le château de l’armée du ruban rouge, c’est un beat’em all avec son lot de boss à combattre pour accéder au niveau suivant. Une progression que l’on suit, avec toujours plus de détachement faute de pouvoir y prendre part. Et ce n’est pas avec la galerie de personnages que l’identification va se renforcer. Au contraire, j’ai eu bien du mal à m’attacher à des protagonistes loin de susciter l’empathie.
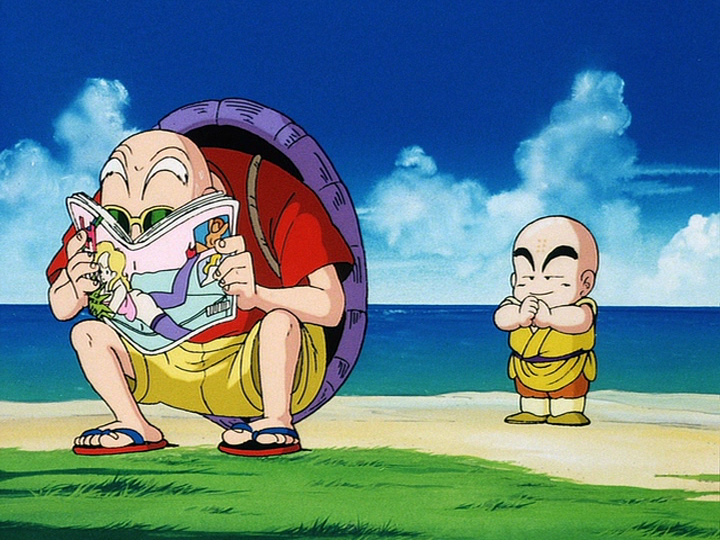
En tête, Tortue génial qui est le ressort comique à travers des blagues sexuelles du plus mauvais gout. À l’opposé de maitre Yoda en ce qui concerne la phase d’entrainement, c’est le beauf par excellence. Mais je n’étais pas au bout de mes peines avec une fille qui change de personnalité à chaque fois qu’elle éternue, ou encore un combattant qui ne s’est pas lavé depuis sa naissance. Dans le genre, c’est un véritable concours à celui qui sera le plus déviant. Et il est bien difficile de les départager, autant que de les supporter.
Fort heureusement, Son Goku n’est pas aussi tête à claque, même s’il encaisse plutôt bien les coups. On suit son évolution jusqu’à le retrouver sous une forme adolescente, dans le dernier tiers, après une ellipse de 3 années. Une sorte de transition qui s’amorce pour annoncer un tournant plus adulte, tel que je le connais avec Dragon Ball Z. On peut d’ailleurs y voir cette ambiance plus sombre à travers l’agression de Krilin, un moment vraiment touchant dans sa mise en scène, mais aussi dans un flashback décrivant un monde post-apo.
Tout ceci est annonciateur d’une atmosphère qui me correspond plus. De ce que je considère comme étant l’identité de l’oeuvre d’Akira Toriyama. Cette plongée dans l’origine de Dragon Ball n’aura pas pour autant été une perte de temps. J’ai pu me familiariser encore plus avec ces personnages, et repérer les petites références qui vont prendre de l’importance par la suite. Je pense notamment à Bulma qui vit dans la ville de Metropolis, ce qui est ironique puisque l’on apprendra plus tard que Son Goku vient d’une autre planète comme Superman.
Kal-el, Kakarot: même combat.
LITTÉRATURE
Alice au pays des merveilles
Bien des personnages ont exploré le pays des merveilles. Et tous en sont revenus transfigurés. Donnie Darko dans le film éponyme, Ofélia dans Le labyrinthe de Pan, Néo dans Matrix, les héroïnes de Sucker Punch, Alice dans la première adaptation de Resident Evil, le chapelier fou en tant qu’ennemi de Batman, les rescapés du vol Océanic 815 dans Lost, et j’en passe. Des oeuvres que j’ai aimées, voir adoré pour la plupart, et qui ne pouvaient que me pousser à découvrir ce roman de Lewis Carroll. Ou plutôt à le redécouvrir.
Ce n’est pas la première fois que je fais cette démarche. Et ce ne fut pas un franc succès. J’ai donc mis ça sur le compte d’une trop grande attente au regard des oeuvres mentionnées ci-dessus. Un mauvais état d’esprit de l’époque était également à envisager pour lui donner une seconde chance. Après tout, j’ai déjà revu à la hausse bien des oeuvres qui ne m’avaient pas laissé une bonne impression. Alors j’ai suivi le lapin blanc pour m’aventurer dans son terrier. Et tout comme Alice, j’ai chuté. Je suis tombé de haut.
De très haut même. L’appréhension en moins puisque le récit était loin de m’être étranger. Mais cette redécouverte n’a fait que confirmer mon premier ressenti. Mon amour pour les références à Alice au pays des merveilles est alors devenu aussi paradoxal que l’histoire qu’elle met en scène. En effet, comment peut-on autant apprécier des allusions à une histoire loin d’être à notre gout? Des sentiments contradictoires qu’Alice va elle-même éprouver dans ce monde de fou. Cette mise en abime s’est donc répercutée sur ma lecture.

Rarement un roman n’aura été aussi immersif, dans le mauvais sens du terme. L’incompréhension fut totale. De la première ligne à la dernière, je n’ai pas réussi à rentrer dans cette histoire d’une fille qui pénètre dans un monde où la logique est mise à rude épreuve. Les rencontres qui ont ponctué son périple, entre le lapin blanc, la reine de coeur, le chat du Cheshire ou encore le Chapelier, n’ont fait que m’exclure un peu plus. Leurs conversations, toute plus insipides les unes que les autres, ont eu raison de mon attention.
Il faut dire que le style de l’auteur est loin d’être un modèle de fluidité. De plus, sa narration oscille entre des situations absurdes et des chansons aux paroles tout aussi abstraites. Tout cela a fait que j’ai eu bien du mal à être réceptif. Mais s’agissant d’un texte à destination des enfants, j’ai persévéré. Puis, je me suis rendu à l’évidence: je ne pense pas qu’il s’agisse d’une question d’âge. Objectivement, je ne crois pas que j’aurais apprécié cette histoire plus jeune. Certes, c’est une opinion impopulaire, mais je l’assume.
Autre paradoxe, ce conte a beau afficher une faible pagination, j’ai mis un temps considérable à le parcourir. De quoi me laisser le temps de murir ma réflexion sur ce classique de la littérature. Et j’en suis venu à la conclusion qu’après autant de contradiction à mon actif, j’ai peut-être été plus investi que je ne le pensais. D’une certaine manière, j’ai ressenti ce qu’Alice a éprouvé face à tant de non-sens au cours de son périple. C’est-à-dire de l’incompréhension, et un chemin vers la sortie.