FOMO n’est pas un faux mot.
Il s’agit de l’acronyme pour Fear Of Missing Out.
C’est un terme qui a gagné en popularité durant le premier confinement pour refléter l’étrange comportement d’une partie de la population. Dont le mien. En effet, comme beaucoup, j’avais notamment peur de « rater » mon isolement si je n’utilisais pas ce temps limité à bon escient. Une crainte d’autant plus renforcée lorsque l’on a une forte tendance à la procrastination.
Pour la plupart, cela s’est traduit par une hyperconnexion afin d’être au courant du dernier événement en date pour profiter de la moindre interaction sociale. Pour moi, cela concerner aussi des sorties, mais des sorties cinéma, de comics, de jeux vidéo… Tous ces supports recèlent une quantité astronomique d’oeuvres que je m’efforce de relayer ici, à travers ce webzine.
D’où son nom.
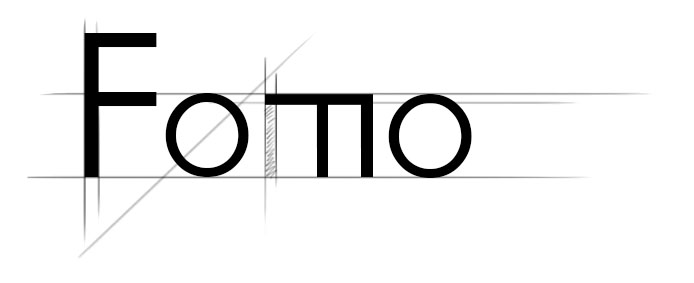
C’est là un moyen pour moi d’être raccord avec l’actualité, mais surtout avec ma consommation assez conséquente en la matière. Ce regroupement sous diverses catégories est donc la solution que j’ai trouvée, puisque je suis dans l’impossibilité de faire des articles pour chaque oeuvre. Quand bien même, chaque contenu ne mérite pas une publication. Par contre, d’autres oui, et c’est l’objet du disclaimer qui suit.
Disclaimer:
Certaines des critiques ci-dessous sont amenées à se développer dans des articles à part entière. Tout dépend de l’intérêt que je porte à l’oeuvre en question. Cela peut être par envie de donner à une découverte plus de visibilité, ou d’avoir à coeur d’analyser dans le détail un coup de coeur. Si l’une ou l’autre de ces conditions est au rendez-vous et que je dispose d’un point de vue qui n’a pas encore été abordé ailleurs, alors je me réserve le droit de lui consacrer une future publication pour revenir en long et en large sur le sujet. Il est alors possible que vous ayez une impression de déjà vu à la lecture. Et pour cause, je vois les critiques qui vont suivre comme de potentielles ébauches.
Mais ne vous y trompez pas, ici ça spoile à balles réelles alors gare aux révélations!
Si malgré cet avertissement vous ressentez le besoin de parcourir ce qui va suivre, alors c’est que vous êtes potentiellement atteint par le syndrome FOMO.
Bienvenue au club.
Dans le club de ceux qui préfèrent perdre quelques minutes à lire une critique, plutôt que de s’investir des heures durant dans une oeuvre qui pourrait potentiellement leur déplaire.
FILMS
Shang-Chi et la légende des dix anneaux / Spider-Man: no way home / Doctor Strange in the Multiverse of Madness / Thor: love and thunder
Avant de me lancer dans un nouveau chapitre du Marvel Cinematic Universe avec Antman et la guêpe: Quantumania, j’ai entrepris un revisionnage de la phase 4. De cette dernière, j’avais jusqu’à présent pu me faire un second avis sur Black Widow et Les éternels. Deux des longs-métrages que je considère comme les plus faibles de cette fournée. Mais aussi du studio Marvel. Même s’ils ont bien des qualités, la sélection suivante en a bien plus à mes yeux. À commencer par Shang Chi et la légende dix anneaux qui fait preuve d’un véritable sens du rythme et de la comédie.

Une combinaison très familière pour Marvel qui en a affiné cette formule, film après film. Cette énergie, on la retrouve mise au service de l’introduction de Shang Chi et du folklore chinois dont il est issu. La part belle est donc laissée à des combats aériens et une vitesse de frappe digne des performances de Jackie Chan. Aussi rapide que Sonic dans ses déplacements sur les plates-formes, la comparaison n’a rien d’insolite pour un récit où il est question d’anneaux. Ces derniers vont être mis à contribution lors d’un dernier acte généreux à souhait. Tellement que la nomination du réalisateur à la tête du futur Avengers: the Kang Dynasty fait sens.

Mais pour l’instant, faute d’une nouvelle réunion au sommet, le crossover récent qui s’en rapproche le plus reste Spider-Man: no way home. Un film fait pour les fans, et qui réalise leur fantasme de voir les précédentes incarnations de l’homme-araignée se joindre au MCU. Les attentes étaient grandes, mais le contrat est rempli à quelques exceptions près. Outre des détails scénaristiques, il manque à ce troisième épisode une véritable personnalité, de celle qu’il y avait dans Homecoming et Far From Home. Jon Watts n’a pas un style très affirmé, mais l’on sent qu’il manque cet état d’esprit à la John Hugues qu’il avait si bien retranscrit jusqu’à présent.

À contrario, Sam Raimi s’en sort à merveille pour conserver sa virtuosité avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On y retrouve Steven Strange qui bénéficie de nouveaux pouvoirs qui sortent des ordinaires matérialisations de cercle orangé. De quoi renouveler l’imagerie du sorcier qui va s’aventurer dans le multivers au rythme d’un montage allant à l’essentiel. Efficace de bout en bout, cela reste une bien meilleure proposition que Everything everywhere all at once sur le même thème. Quand bien même ce dernier a été loué pour sa folie, elle reste bien en deçà de celle de Thor: Love and Thunder.

Un joyeux bordel que j’ai adoré, de sa superbe séquence d’intro, voyant Gorr renoncer à toute humanité, jusqu’à cette fin pleine de rédemption. Un adversaire de taille pour le dieu du tonnerre et qui figure parmi les meilleurs méchants du MCU. Même s’il est visuellement différent de sa version papier, devenant une sorte de Gollum corrompu par la nécrolame, ses intentions sont les mêmes. Mais la manière dont il s’y prend pour son déicide à grande échelle diffère. Dans les comics, son plan consiste à faire exploser une bombe temporelle. En reprenant cette idée, cette explosion aurait pu rompre la continuité et ainsi déboucher sur le multivers. Soit la thématique principale de la nouvelle saga du MCU.
SÉRIES
Parallèles / Dark Stories
Faire de la fiction de genre en France n’est pas seulement une question de moyens. Peu importe le budget, c’est une catégorie qui a longtemps usé du système D pour mettre en image ses idées les plus folles. Et puis, il y a un autre système D. Le système Disney. La stratégie de ce géant consiste soit à récupérer des licences libres de droits, ou acheter à prix d’or des studios en difficulté. Mais lorsque ça n’est pas possible d’absorber la concurrence, il la copie. Ainsi, pour les besoins de sa plate-forme de streaming, le numéro 1 du divertissement s’est mis en tête de copier Netflix et sa série phare: Stranger Things. Et aussi Dark.
Le résultat, c’est Parallèles. Sous couvert d’un appel à projets pour produire du contenu made in France, Disney + sélectionne le projet de Quoc Dang Tran. Une idée en gestation dans l’esprit du scénariste depuis 2010, mais qui n’a jamais trouvé les financements nécessaires dans l’hexagone. Pas étonnant avec un pitch qui part dans tous les sens. Visiblement, les années ne lui auront pas permis de clarifier son propos. Malgré un postulat de base assez simple voyant une bande d’ados se retrouver pour fêter l’anniversaire de l’un d’entre eux, l’histoire se divise en plusieurs intrigues. Parallèles, bien sûr. Mais surtout bordéliques.

D’un côté, on a donc Romane et Victor qui vivent dans une réalité où Bilal et Sam ont mystérieusement disparu, et vice versa. À ceci prêt que dans la dimension de Sam et Bilal, ce dernier a pris 15 ans de plus. À ce concept à la Leftovers, il faut donc rajouter un délire à la Big. Et comme si ça n’était pas suffisant, l’un d’entre eux va se mettre à développer des pouvoirs… Entre du voyage dans le temps, des disparitions qui se répercutent dans un univers parallèle, un ado dans la peau d’un adulte, des dons surnaturels qui apparaissent, difficile de trouver une justification cohérente pour lier tous ces éléments entre eux.
Encore une fois, l’accélérateur de particules a bon dos. Après les séries The Flash et Flashforward qui en ont fait usage pour étoffer leur background, ce ressort scénaristique a fini par devenir la réponse à tous les auteurs dans une impasse. Mais ça n’est pas suffisant pour maintenir la suspension d’incrédulité. Dès lors, les 6 épisodes peinent à convaincre et l’on se raccroche à certains effets de mise en scène sympa. Notamment lorsque la caméra se retourne pour passer d’une dimension à une autre. La meilleure transition étant de passer d’une chaine à une autre. Ce que j’ai fait en zappant sur France TV.

Évidemment, il y a moins de visibilité, encore moins de budgets, mais beaucoup plus de qualités. Et j’en suis moi-même le premier surpris concernant Dark Stories. Moi qui m’attendais à une série potache avec un soupçon de surnaturel, j’ai eu tout l’inverse. Des appréhensions tout à fait légitimes au regard de l’équipe à la barre de cette anthologie. J’ai beau être réceptif à l’humour de François Descraques et sa troupe, j’avais quelques réserves sur les autres intervenants. Mais mes doutes ont été levés dès le premier épisode. Si quelques traits d’humour sont bien présents, c’est le fantastique qui prédomine.
Cette première histoire met en scène une femme en proie à une créature maléfique durant son sommeil. Et contre toute attente, cela m’a déclenché quelques frissons. Une sensation que n’a pas atténuée la présence de Slimane-Baptiste Berhoun venu prêter main-forte à son amie. Identifier comme étant le docteur Castafolte dans Le visiteur du futur, le voir dans un autre rôle pour la première fois m’a permis de voir la facette dramatique de son jeu. Même constat pour Florent Dorin, dans le troisième segment, que je ne connaissais que pour sa prestation de visiteur déjanté.

Le récit dans lequel il prend place le voit faire face à un autre type de visiteur. Ceux venus de l’espace. Néanmoins, le comédien reste diriger par François Descraques pour un scénario qu’il a lui-même écrit. Un scénario qui contient quelques dialogues en anglais pour les besoins de l’intrigue. Étonnant pour une production qui vante sa French touch. Mais c’est surtout le langage cinématographique de Descraques qui impressionne. Depuis sa web-série, le réalisateur a gagné en assurance avec une belle mise en scène. Mention spéciale pour les plans zénithaux vraiment superbes.
Mais cet épisode est surtout l’occasion de convoquer la nouvelle et l’ancienne génération d’acteur. Dominique Pinon trouve ainsi sa place en tant que fermier persuadé de l’imminence de la fin du monde. L’ironie est alors totale face à un Florent Dorin sceptique, mais qui prédit l’apocalypse dans chaque saison du Visiteur du futur. Des rôles à contre-emploi donc, pour des performances vraiment réussies. Même type de rencontre dans l’épisode 4 où l’actrice Delphine Chanéac à pour partenaire de jeu Julien Pestel, surtout connu pour des sketchs sur le web avec le Palma Show et les collectifs Golden Moustache et Studio Bagel.
Cette différence dans leur carrière ne se fait pas ressentir grâce à une réalisation inspirée et une ambiance pesante. Mais surtout, car les véritables stars sont les goules du titre. Elles révèlent une morphologie particulièrement intéressante. Celle de la poupée maléfique du dernier épisode l’est beaucoup moins. Il faut dire qu’en prenant l’apparence de Davy Mourier, cela prête plus à sourire qu’autre chose. Du moins, jusqu’à ce que l’histoire se développe pour sortir du cliché de la marionnette terrifiante, et proposer quelque chose d’inédit. C’est là que cette série prend une tournure moins anthologique qu’elle n’y parait.

En effet, ce cinquième épisode se permet de relier toutes les histoires en un tout cohérent. Qui plus est justifié par sa propre intrigue, tout en pouvant se regarder indépendamment du reste. Même si j’ai quelques réserves sur le deuxième épisode qui voit un homme ne pouvait pas mourir confronter à la fragilité de son corps, c’est un tour de force qui conclut à merveille cette compilation. Et qui surtout réussit là où Parallèles a échoué en ne parvenant pas à donner une cohérence à ses différents éléments. En cela, je préfère cinq petites histoires parfaitement exécutées, qu’une seule incompréhensible.
LITTÉRATURE
Stranger Things: Suspicious minds
L’avantage avec les récits se déroulant dans le passé, c’est qu’ils sont limités par les technologies de l’époque. Pas de risque donc de voir des facilités scénaristiques pour résoudre une situation en un coup de fil avec son smartphone. Si anachronisme il y a, cela s’est situé de mon côté puisque le premier livre que j’ai inauguré sur ma liseuse fut Stranger Things: Suspicious minds. Soit un univers où non seulement le téléphone portable n’a pas encore été inventé, mais où les livres numériques ne sont même pas à l’ordre du jour.
Car si la série Netflix se situe dans la nostalgie des années 80, ce roman dérivé en est une préquelle prenant place à la fin des années 60, début 70. On y suit Terry, une jeune femme qui apprend par sa colocataire qu’un laboratoire effectue des tests en échange d’une rémunération. Elle se laisse d’autant plus tenter que ces expériences tournent autour du LSD. Mais ce n’est là que la face visible de cette organisation que l’on a pu découvrir à travers les premières saisons de Stranger Things.
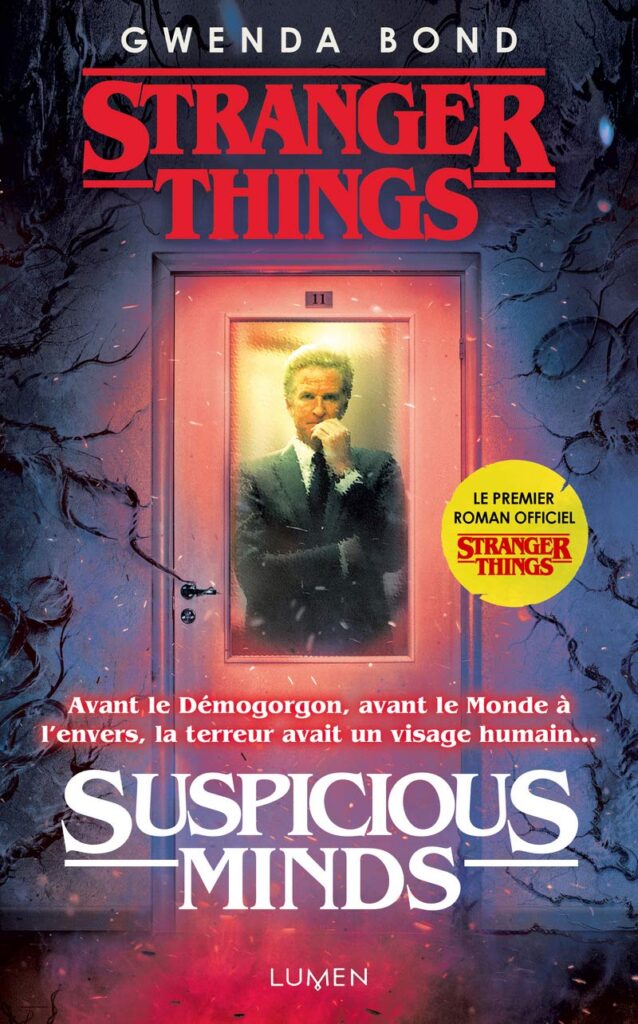
C’est à l’autrice Gwenda Bond que revient la charge de développer les événements antérieurs à la création des frères Duffer. Son style est suffisamment fluide pour rendre la lecture agréable. Mais dans le cadre d’une licence déjà existante, c’est surtout l’histoire qui importe. Plus encore lorsqu’elle promet d’en explorer les fondations. D’ordinaire, ce genre de retour en arrière est l’occasion de donner des circonstances atténuantes à des personnages détestables, pour comprendre leur psychologie, mais certains semblent être nés ainsi.
Je fais bien sûr allusion au fameux docteur Brenner que l’on retrouve ici égal à lui-même. Manipulateur, menteur, calculateur: rien ne joue en sa faveur. Même si numéro 8 l’appelle « papa », cela n’en fait en rien un individu sympathique. Au contraire, cela ne fait que rajouter la notion de ravisseur à un profil déjà bien chargé. Face à lui, il devra affronter un groupe d’adolescents que l’on peut voir comme une version préliminaire de celle de la série principale. En bien moins charismatique. Il faut dire que le format littéraire est bien moins efficace qu’une série ou un film pour retranscrire toute l’ambiance d’une époque.
Pourtant, l’écrivaine fait des efforts pour contextualiser son histoire en utilisant la guerre du Vietnam en toile de fond, l’alunissage, la mention des romans du Seigneur des anneaux, et même Suspicious minds qui est une chanson d’Elvis Presley. Mais tous ces éléments ne pèsent pas grand-chose face à l’absence de suspense palpable dans toute préquelle. Même si l’on en sait plus sur les circonstances autour de la naissance de 11, il aurait été préférable de distiller ces chapitres sous la forme de flashbacks dans la série.
COMICS
Unholy Grail / Green Valley
Je n’ai jamais vraiment eu d’affection pour les récits moyenâgeux. Il faut dire que les cours d’Histoire n’ont jamais été ma matière préférée dans mon emploi du temps. J’employais souvent ce dernier à gribouiller des histoires dans le fond de la classe en attendant la sonnerie. Jusqu’à ce que j’apprenne que nombre de mythes et de légendes avaient servi de base aux sagas modernes que j’adorais. Notamment La tour sombre de Stephen King. Dès lors, j’ai été un peu plus ouvert sur les écrits de cette période, mais ce sont surtout les adaptations filmiques qui m’ont permis d’approfondir le sujet.
En effet, bien des récits actuels ont pour racines des aventures antiques, mais ces dernières ont également su se renouveler en se modernisant. Dans le genre, Le roi Arthur: la légende d’Excalibur fait figure de trahison pour les puristes. Ce blockbuster signé Guy Ritchie se moque des conventions pour un croisement entre le jeu vidéo, la fantasy et une action débridée. Autant dire que j’ai adoré cette réinvention. Ce mélange des genres, je pensais le retrouver dans Unholy Grail qui traite lui aussi de légendes arthuriennes sous le prisme de l’horreur.

À l’écriture de ce comics, mais surtout à la réécriture de cette fable, le scénariste Cullen Dunn y insuffle une ambiance sombre à souhait. Pour ce faire, il modifie un seul élément qui sert de pitch à ce one shot: l’identité de Merlin est usurpée par un démon qui va ensuite manipuler tout un royaume pour parvenir à ses fins. Un point de départ intriguant, mais qui donne juste un autre point de vue sur les événements que l’on connait déjà. On enchaine alors les intrigues de cours, les trahisons, les adultères, les faux semblants… Et quelques batailles en guise de temps forts.
Malgré ce parti pris intéressant, l’ennui se fait vite ressentir. Et les dessins n’aident pas à renouveler l’intérêt de cette lecture. Le trait de Mirko Colak ne m’a pas convaincu, sans pour autant être mauvais. C’est d’autant plus lisible que la narration n’empiète pas trop sur ses cases. Même si certaines pleines pages sont bien composées, je n’ai pas accroché à ses illustrations. Pourtant, tout avait bien commencé dans une atmosphère noire rappelant le Beowulf de Robert Zemeckis. Puis, au fil des numéros, cela a sombré dans les méandres du Beowulf mettant en vedette Christophe Lambert.

Il en ressort un moment pas désagréable, mais pas mémorable pour autant. L’inconvénient, c’est que ceux qui seront les plus susceptibles d’apprécier à sa juste valeur Unholy Grail, sont les mêmes qui rejetteront en bloc cette proposition déviante. Il est difficile de ne pas voir dans ce comics une profanation des écrits mythologiques. Pour autant, il faut avoir ce bagage culturel pour y voir les différences, les réinterprétations des personnages, les références… Un public se trouve donc dans cette contradiction entre respect de l’oeuvre d’origine, et le renouvellement de cette mythologie. Un public dont je ne fais pas partie.
Toutefois, je me sens plus proche de l’état d’esprit des seconds que des premiers, et c’est pourquoi j’ai adoré Green Valley. Là, il n’est pas question d’écrits légendaires. Juste une histoire de chevalerie, et qui plus est sans la moindre once de fantasy. Pas de roi Arthur donc. En tout cas, s’il y a bien un roi de ce nom auquel ce comics pourrait rendre hommage ça serait à celui de la science-fiction Arthur C. Clarke, et de sa citation qui veut que toute technologie suffisamment avancée soit indiscernable de la magie. Une loi que le scénariste Max Landis va faire sienne pour les besoins de son récit.

Ainsi, c’est la crédulité de ses personnages qui est mise en avant pour mieux introduire cette magie. Un quatuor de chevaliers s’y retrouve donc confronter lorsque l’on vient réclamer leur aide pour combattre un sorcier. Celui-ci sévit à Green Valley, un petit village verdoyant qui donne son titre à ce one shot. Ces quatre héros, plus connus sous le nom de chevalier de Kélodie, sont donc dépêchés sur place, prêts à relever un défi sans vraiment croire qu’un ennemi surnaturel les attend au bout de cette quête. Tout n’est qu’une question de point de vue: pour eux cet adversaire s’avère être un puissant sorcier, pour le lecteur il y a comme de l’anachronisme dans l’air. Ou dans l’ère.
Et ce n’est pas peu dire. Après un premier affrontement dans l’enceinte du village qui leur aura valu la perte d’un de leur combattant, les chevaliers s’aventurent dans les bois environnant pour débusquer cet ennemi. Leur vengeance sera néanmoins retardée par des créatures à la solde de celui qui se fait appeler Cyril le noir. Les histoires de dragons auxquelles ils se refusaient à croire prennent alors vie, tout en essayant de leur enlever la leur. Mais ces reptiles géants s’avèrent être des dinosaures et dès lors, le prétexte du voyage dans le temps ne fait plus aucun doute.

Devant cette évidence, Max Landis a le bon sens de ne pas faire durer le suspense et introduit d’emblée une police temporelle. Pas de quoi complexifier l’intrigue, au contraire cette révélation de mi-parcours est au service des personnages. Ces derniers sont suffisamment développés pour contrebalancer la simplicité du récit dans lequel ils prennent place. On s’attache très vite aux chevaliers de Kélodie, à leur esprit de groupe, et les dessins de Giuseppe Camuncoli n’y sont pas pour rien. Mais tout comme ce scénario aurait pu être signé Mark Millar, le trait de l’illustrateur m’a rappelé celui d’Olivier Coipel.
À tel point que j’ai cru que c’était le dessinateur français à la partie graphique. Pas étonnant que les deux artistes aient été amenés à collaborer sur des travaux similaires, comme par exemple Spider-verse de Dan Slott. Leur style se complète, tout comme un dragon est semblable à un dino. Toutefois, c’est à Camuncoli que revient le privilège de dessiner des chevaliers face à un bestiaire composé de T-Rex et autres raptors. Un délire que l’on pourrait comparer à celui de Cowboys et envahisseurs, mais surtout au film Outlander: le dernier viking. Mais peu importe où Max Landis est allé puiser son inspiration, Green Valley est un récit qui a sa propre identité. Et surtout qui a du coeur.
COURT-MÉTRAGE
Uncharted VS Tomb Raider VS Indiana Jones
Bien qu’il ait lui-même été influencé par les serials des années 40, le succès d’Indiana Jones à engendrer la création de pas mal d’ersatz. De pales copies dont une a réussi à sortir du lot en étant à l’opposé du love interest susceptible d’atterrir dans les bras du célèbre archéologue: Lara Croft. Cette version féminine à Indy est longtemps restée indétrôner dans l’industrie vidéoludique. Du moins, jusqu’à l’arrivée de Nathan Drake sur la nouvelle génération de console. Un aventurier dont les créateurs ont pris soin de revenir à la source d’inspiration initiale.
Ces trois icônes étaient donc faites pour se rencontrer. Mais pas forcément autour d’un verre. Plus à l’occasion d’une chasse au trésor. Et pas en tant que partenaires, plutôt des concurrents comme le met en scène ce court-métrage très justement intitulé Uncharted VS Tomb raider VS Indiana Jones. On peut difficilement faire plus limpide comme appellation. Et aussi plus attractif. Trois têtes d’affiche pour le prix d’une, et comme ces licences ne sont pas sous la même juridiction, c’est aux fans que revient la charge d’organiser cette rencontre.
Le réalisateur Devin Graham en fait partie. Et il n’est pas allé chercher bien loin un prétexte pour les réunir autour d’une même histoire. En effet, il n’est pas rare de voir leurs épisodes respectifs s’ouvrir sur un concurrent qui cherche à s’emparer d’une relique durement acquise. Un cliché suivi de bien d’autres comme la mention d’une légende, un sanctuaire qui est profané, des aventuriers qui essayent de s’échapper avant que tout ne s’écroule autour d’eux… Pour l’originalité, on repassera.
En cela, le scénario n’en est pas vraiment un, il s’agit juste de rattraper un McGuffin qui passe de main en main durant un peu moins de 10 minutes. Pas besoin de temps supplémentaire tant ces personnages sont devenus des icônes de la pop culture qui n’ont plus besoin d’être présentées. Il suffit de les voir en action avec le fameux chapeau, l’arc et le keffieh pour les reconnaitre. Par contre, il manque le personnage affilié à cette dague qui fait office d’objet de tous les désirs: celle qui permet au prince de perse de remonter le temps.
Il se serait à coup sûr épanoui dans les magnifiques décors de l’Uzbekistan. Peut-être plus tard dans une version longue. De là à dire aux studios détenteurs des droits d’arrêter de s’entêter à adapter Uncharted, à rebooter une fois encore Tomb Raider ou a donné une énième suite à Indiana Jones, ils feraient mieux de s’entendre sur une aventure commune comme celle-ci. Faute de mieux, et même si les acteurs ne sont pas les plus ressemblants, on retrouve la personnalité de chacun d’entre eux dans leur attitude. Pour faire totalement illusion, la prochaine étape sera d’utiliser la technologie du deep fake pour donner une autre envergure à cette aventure.
CINÉMA
The Fabelmans / Knock at the cabin
Le dernier Spielberg. Sans même mentionner le titre, c’est de cette manière dont on parle du dernier film en date de l’un des plus grands cinéastes de sa génération. Le dernier Spielberg, donc. Bientôt, cela sera à prendre au sens littéral, mais pas encore. Néanmoins, à 76 ans, on sent que le cinéaste approche de la fin de sa carrière. Le nombre de films qu’il peut encore réaliser est compté. Avant qu’il n’en soit plus capable, avant qu’il ne soit trop tard. C’est surement pour cette raison qu’il n’a pas rempilé pour le cinquième Indiana Jones afin de se consacrer à des projets plus personnels.
Parmi ces projets qui lui tenaient à coeur, il y avait le remake de West Side Story, et une autobiographie: The Fabelmans. Et qui de mieux pour raconter l’histoire du plus célèbre des réalisateurs, que le plus célèbre des réalisateurs? Cette introspection permet au cinéaste d’avoir un regard extérieur sur son vécu. De revenir à l’origine de sa passion jusqu’à ce que cela devienne son métier. Parfois, on fait quelque chose depuis tellement longtemps, qu’il est important de revenir en arrière pour s’en rappeler les raisons. C’est ce que semble faire Steven Spielberg, tout en évitant de verser dans l’auto-référencement.

Ça, il l’a déjà fait avec Ready Player One. Qui plus est, avec brio. Là, il évite soigneusement les allusions maladroites à son propre travail susceptible de raccrocher la réalité à la fiction. En cela, The Fabelmans est à l’opposé du biopic sur Tolkien, dont beaucoup de sous-entendus étaient faits au Seigneur des anneaux afin de donner une indication de ce qui avait pu inspirer la saga phare à l’auteur. Même si l’on devine ce qui animera ses centres d’intérêt, notamment son investissement chez les scouts qui évoque la scène d’introduction d’Indiana Jones et la dernière croisade, Spielberg préfère se concentrer sur les émotions de son cinéma.
Et s’il y a une thématique qui revient souvent dans sa filmographie, c’est celle de la famille. Plus précisément, une cellule familiale brisée. D’E.T. à La guerre des mondes, en passant par Le monde perdu ou encore Minority Report et Arrête-moi si tu peux, ces histoires mettent en scène l’absence d’un parent, et l’échappatoire qui en découle pour fuir cette réalité. Cette idée, Spielberg l’évoque dès l’introduction le mettant en scène avant d’aller voir son premier film au cinéma. Il fait alors face aux recommandations de ses parents qui à tour de rôle lui expliquent ce qu’il s’apprête à vivre comme expérience.

Son père lui déclame alors un discours très technique pour un enfant, juste avant que sa mère ne prenne le relai avec des mots plus rassurants. Mais surtout plus centré sur l’émotion, le ressenti… Sur la magie du spectacle. En une seule séquence, Spielberg pose ses enjeux d’une manière claire et naturelle. On saisit alors d’emblée la dualité qui va l’habiter, mais aussi celle qui oppose ses parents. Pour les incarner, le réalisateur a choisi l’excellent Paul Dano, très touchant en père pragmatique, mais surtout Michelle Williams pour incarner sa mère.
J’ignore si le choix de cette dernière est conscient, mais j’ai eu la sensation d’une mise en abime par rapport à sa carrière. En effet, l’actrice s’est notamment fait connaitre grâce à la série télévisée Dawson où elle y interprétait la petite amie du personnage principal. Un personnage fan absolu de Spielberg et qui aspirait à devenir réalisateur à son tour. Coïncidence ou non, cela a participé à mon immersion dans les jeunes années du cinéaste. Une période qui le voit incarner par deux acteurs différents, Mateo Zoryon Francis-DeFord et Gabriel LaBelle, tout aussi bon l’un que l’autre.

Ils ont cette étincelle dans le regard si cher à la célèbre Spielberg Face. Que ce soit lorsqu’il regarde un film, ou quand il commence à les faire lui-même, Sam, l’alter ego du réalisateur, offre un reflet au spectateur qui s’émerveille. Un exemple de plus que Spielberg n’a plus rien à prouver en ce qui concerne la direction d’acteur. Et l’on peut même avoir un aperçu de ces coulisses lorsque son personnage se prête à l’exercice. Le voir donner ses directives à un adolescent de son âge montre sa grande maturité. Ainsi qu’un état d’esprit de leader dès ses premiers courts-métrages.
L’un d’entre eux, intitulé Escape from Nowhere, est l’illustration parfaite de ce qu’est un tournage. Faire un film, c’est une guerre. Et quoi de mieux qu’un film de guerre pour illustrer cette idée. De plus, à l’époque, le cinéaste mettait déjà sa créativité à l’épreuve pour toute sorte de trucage: des impacts de balles dans le sol simulés par des planches en bois et déclenchés par les acteurs, les trous dans la pellicule pour donner l’illusion des coups de feu… Une ingéniosité de tous les instants, mais qui confirme surtout le talent de Sam Fabelman pour la mise en scène.

C’est vraiment génial de voir à l’écran quelqu’un de passionner, qui se bat pour ce qu’il aime faire. Sans le côté torturé de la chose. C’est un artiste en devenir dévoué à son art, sans pour autant se nourrir de son malheur pour créer. Pourtant, Sam n’est pas forcément bien dans sa peau. Entre l’antisémitisme dont il est la cible à l’école, le déménagement qui lui fait perdre ses repères au point de délaisser sa passion, et les soupçons d’infidélité autour de sa mère, il y a de quoi le plaindre. Mais il ne s’appesantit jamais sur son sort. Au contraire, il se réfugie dans le cinéma pour oublier ses problèmes.
Ou comme un moyen de communication. Tout ce qu’il ne peut dire avec des mots, il le dit avec des images. C’est notamment flagrant lorsque sa mère lui reproche d’être distant avec elle, mais qu’il n’arrive pas à exprimer ce qu’il lui reproche verbalement. Sans la moindre parole, Sam la guide alors jusqu’à son rétroprojecteur pour lui montrer les rushs de leur film de vacances. Les scènes coupées. Celles qu’il s’est refusé à mettre dans le montage final par refus de voir la vérité en face. Un moment déchirant, mais nécessaire.

Pour contrebalancer cette négativité, le récit passe souvent de la tragédie à la comédie. Ainsi, le film se révèle très drôle comme en témoigne une direction d’acteur qui finit par déborder après le « couper! » d’une scène, ou encore les premiers émois amoureux lorsqu’il est invité chez une fille pour « prier ». Mais qu’il s’agisse d’amour ou de religion, il est clair que Sam Fabelman est amoureux de sa caméra et que sa religion n’est autre que le cinéma. C’est par ce prisme que l’on voit ce long-métrage, et non à travers la véracité des faits.
Cela a beau être une production estampillée Spielberg par Spielberg, le réalisateur n’en demeure pas moins un narrateur non fiable. Il a beau avoir vécu les événements de l’intérieur, la mémoire a altéré ces moments au fil des ans. C’est à se demander lesquels ont été amplifiés, ou atténués, sous le coup de l’émotion. Ce qui est sûr, c’est qu’ils ont été romancés pour tenir sur 2h30. Une durée qui passe bien trop vite, car très inspirant et positif. Dès lors, on a envie de continuer à suivre les aventures de cet apprenti cinéaste, de voir les autres rencontres déterminantes qu’il va faire et qui vont le façonner.

Même s’il n’est que de passage, Boris, l’oncle de Mitzi, fait partie de ces rencontres qui changent une vie. Qui ont fait de Sam l’homme qu’il est aujourd’hui. John Ford, incarné par David Lynch, compte également parmi ces échanges, brefs, mais intenses. Ainsi, par un concours de circonstances, son idole lui accorde une entrevue dont il ressort avec un précieux conseil: la ligne d’horizon en haut ou en bas, c’est intéressant, au milieu c’est ennuyeux. De là à se demander si la mise en scène de The Fabelmans ne joue pas avec cette règle tout du long, avant de nous l’exposer à la toute fin.
À voir lors d’un nouveau visionnage. En tout cas, ce qui est sûr, c’est la place de Steven Spielberg en tant que narrateur non fiable. Si l’on pouvait avoir des doutes sur l’authenticité de ses souvenirs, la conclusion confirme ce point de vue omniscient. En effet, le plan final brise le quatrième mur de la plus belle des manières. Il aura suffi d’un léger mouvement de caméra pour que Sam prenne le contrôle de sa vie, le contrôle du film de sa vie. Une jolie mise en abime que l’on pourrait interpréter comme un clin d’oeil de Sam à Steven. Ou quand Sam devient Steven. Le reste appartient à l’Histoire.

Une histoire dans laquelle d’autres se sont reconnus. Car si le cinéaste est la somme de ces influences, il a aussi influencé à son tour nombre de réalisateurs en quête d’un modèle. Ainsi, chaque nouvelle génération voit apparaitre son nouveau Spielberg. Ce fut le cas pour M. Night Shyamalan, avant qu’il ne se fasse un nom dans cette industrie. Bien qu’ils évoluent tous deux dans des genres différents, leur dernier film en date ont en commun cette notion de choix. Si dans The Fabelmans Sam est tiraillé entre sa famille et son art, dans Knock at the cabin, c’est une famille à qui revient le dilemme de décider du sort de l’humanité.
Un point de départ improbable, mais qui parle à tout le monde. Ou en tout cas qui peut faire parler beaucoup de monde. Car les meilleures histoires sont celles qui impliquent le spectateur. Elles les forcent à prendre parti, ou mieux, à s’interroger: qu’est-ce que je ferais à leur place? Quelle option choisirais-je? Lorsque l’on en vient à se poser ce genre de question, alors d’une certaine manière le film a réussi son pari. C’est l’art de l’implication. Partir d’une situation anodine que tout le monde connait, à savoir être chez soi, ou sur son lieu de vacances, et voir des inconnus débarquer pour nous confronter à un choix impossible.

Impossible, mais qui suscite néanmoins la réflexion. Mais d’abord vient l’incompréhension. C’est à cela que vont être confrontés Éric, Andrew, et leur fille Wen. En vacances dans la fameuse cabane du titre, ce havre de paix isolé au milieu des bois va se transformer en anti-chambre de l’enfer avec l’arrivée de 4 individus. Un quatuor qui s’apparente aux 4 cavaliers de l’apocalypse au regard de leur discours: la fin du monde approche et pour l’enrayer, ce couple et leur fille doivent sacrifier l’un d’entre-eux en guise de rituel. S’il s’y refuse, ils seront les seuls survivants des plaies qui vont s’abattre sur le monde.
Pour ce qui est de leurs plaies suite à l’intrusion de ces deux hommes et ces deux femmes, ces intrus ont pris soin de les soigner. Un comportement bien loin de personnes dont les intentions sont mauvaises. Ce qui aurait pu se transformer en torture porn dans la lignée de Funny Game US, prend donc une tout autre tournure. Sorte de mélange entre The Box et Cabin in the Wood, cette adaptation du roman de Paul G. Tremblay se révèle plus profonde qu’elle n’y parait. Car malgré leur captivité, les protagonistes ont réellement le choix.

Ils doivent décider entre être spectateurs de la fin du monde, ou devenir acteurs de son sauvetage. Et pour les incarner, le casting composé par Shyamalan est vraiment à la hauteur. Jonathan Groff et Ben Aldridge forment un couple crédible à l’écran, loin des clichés. De plus, ils bénéficient de flashbacks permettant de mieux comprendre leur personnalité respective. Et de mieux comprendre leurs réactions face à leurs tortionnaires, si l’on peut les appeler ainsi. Ces derniers sont interprétés par Nikki Amika-Bird et Abby Quinn, toutes deux excellentes, mais aussi Rupert Grint égal à son rôle dans Servant.
Pour ce qui est de leur leader, c’est Dave Bautista qui lui prête ses traits, et surtout sa carrure. Une présence qui en impose, mais qui est mise en contraste avec une attitude à l’opposé. Comme sa carrière d’ailleurs, à contre-courant de ce que son physique lui impose. Cet ancien catcheur aurait pu enchainer les films d’action à la The Rock et vite tomber dans l’oubli. Du moins, il n’a pas fait que ça en diversifiant sa filmographie avec des seconds rôles qui mettent en avant une autre facette de son jeu. Et avec Knock at the cabin, il ajoute un nouveau réalisateur talentueux à son palmarès qui compte déjà James Gunn, Sam Mendès, Denis Villeneuve, Rian Johnson ou encore Zack Snyder.

M. Night Shyamalan parvient à tirer de lui une sorte de délicatesse, une fragilité insoupçonnée. Mais là où le cinéaste excelle, c’est dans ses interactions avec la petite Wen. Jouée par Kristen Cui, la jeune actrice est loin de l’image irritante des enfants dans les films. Par contre, ce qui l’est plus, c’est le manque d’audace pour résoudre la problématique de l’intrigue. En effet, production américaine oblige, on sait d’emblée que cette fillette ne sera pas sacrifiée sur l’autel de la fin du monde. Le contraire aurait été un twist surprenant. Soit la marque de fabrique de Shyamalan. Là, il n’en est rien.
Ou en tout cas, sans en révéler la teneur, ce retournement de situation ne figure pas parmi ses plus ingénieux. À l’arrivée, il s’agit juste d’une question de vie ou de mort. C’est dommage, car il y a bien des questions qui fâchent. De celles qui peuvent créer de la discorde au sein d’une famille. Du genre: quel est ton enfant préféré? Étant fille unique, ce cas ne s’applique pas à Wen. Mais la réciproque aurait permis de créer du conflit: tu préfères ton père ou ta mère? Le dilemme est le même lorsque l’on a deux papas comme ici.

Et bien que ce type d’interrogation ne porte pas à conséquence en temps normal, là c’est tout le destin du monde qui aurait pu se jouer sur la préférence d’une enfant. Sous couvert d’innocence, bien sûr. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants, cela aurait permis de passer de la théorie à la pratique lors d’une situation d’extrême urgence. Mais le scénario ne manque pas de tension pour autant. C’est un huis clos nerveux et efficace de bout en bout. Désormais, la traditionnelle cabane dans les bois n’évoquera plus seulement les Evil Dead en tant que potentiel horrifique, mais aussi Knock at the cabin.