FOMO n’est pas un faux mot.
Il s’agit de l’acronyme pour Fear Of Missing Out.
C’est un terme qui a gagné en popularité durant le premier confinement pour refléter l’étrange comportement d’une partie de la population. Dont le mien. En effet, comme beaucoup, j’avais notamment peur de « rater » mon isolement si je n’utilisais pas ce temps limité à bon escient. Une crainte d’autant plus renforcée lorsque l’on a une forte tendance à la procrastination.
Pour la plupart, cela s’est traduit par une hyperconnexion afin d’être au courant du dernier événement en date pour profiter de la moindre interaction sociale. Pour moi, cela concerner aussi des sorties, mais des sorties cinéma, de comics, de jeux vidéo… Tous ces supports recèlent une quantité astronomique d’oeuvres que je m’efforce de relayer ici, à travers ce webzine.
D’où son nom.
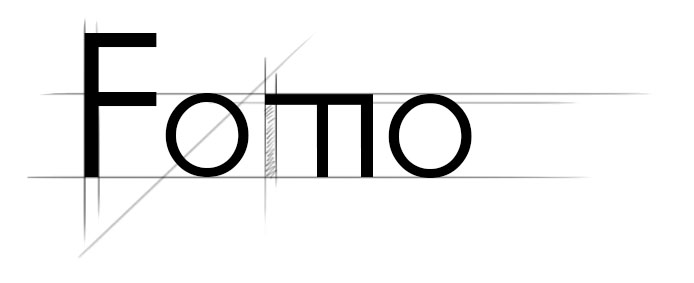
C’est là un moyen pour moi d’être raccord avec l’actualité, mais surtout avec ma consommation assez conséquente en la matière. Ce regroupement sous diverses catégories est donc la solution que j’ai trouvée, puisque je suis dans l’impossibilité de faire des articles pour chaque oeuvre. Quand bien même, chaque contenu ne mérite pas une publication. Par contre, d’autres oui, et c’est l’objet du disclaimer qui suit.
Disclaimer:
Certaines des critiques ci-dessous sont amenées à se développer dans des articles à part entière. Tout dépend de l’intérêt que je porte à l’oeuvre en question. Cela peut être par envie de donner à une découverte plus de visibilité, ou d’avoir à coeur d’analyser dans le détail un coup de coeur. Si l’une ou l’autre de ces conditions est au rendez-vous et que je dispose d’un point de vue qui n’a pas encore été abordé ailleurs, alors je me réserve le droit de lui consacrer une future publication pour revenir en long et en large sur le sujet. Il est alors possible que vous ayez une impression de déjà vu à la lecture. Et pour cause, je vois les critiques qui vont suivre comme de potentielles ébauches.
Mais ne vous y trompez pas, ici ça spoile à balles réelles alors gare aux révélations!
Si malgré cet avertissement vous ressentez le besoin de parcourir ce qui va suivre, alors c’est que vous êtes potentiellement atteint par le syndrome FOMO.
Bienvenue au club.
Dans le club de ceux qui préfèrent perdre quelques minutes à lire une critique, plutôt que de s’investir des heures durant dans une oeuvre qui pourrait potentiellement leur déplaire.
FILMS
Uncharted / Fast and Furious 9 / Fast and Furious : Hobbs et Shaw / Bullet Train
Parfois, les cinémas peuvent être comparés à des fast foods. On y voit des films qui nous divertissent sur le moment. Et que l’on oublie aussitôt sortie de la salle. Mais comme la mal bouffe, cela reste tout de même un plaisir coupable. Tellement qu’il m’arrive de remettre le couvert à domicile. De prendre à emporter pour savourer cette débauche dans mon salon. J’ai donc revu ces blockbusters estivaux à l’abri des regards, à commencer par Uncharted. Même si les jeux sont paradoxalement beaucoup plus cinématographiques, il y a tellement peu de long-métrage d’aventure ces derniers temps que je n’ai pas voulu snober celui-ci.

Ce fut donc un plaisir de revoir Tom Holland dans cette variante des Aventures du jeune Indiana Jones. Son incarnation de Nathan Drake est toujours aussi rafraichissante, même si Mark Wahlberg collait bien plus au personnage. Toutefois, leur alchimie fonctionne plutôt bien. Surtout avec l’arrivée d’un chat, alias Monsieur Moustache, dont Sully semble ne plus vouloir se séparer. C’est un élément absent des jeux de Naughty Dog, mais qui s’inscrit dans les good vibes de cette adaptation. Du moins, dans cette réinterprétation qui va piocher dans la quadrilogie vidéoludique pour construire son intrigue.
Mais même si la scène de l’avion, tirée du troisième jeu, n’a rien à faire avec les débuts de Nathan, elle conserve tout de même son potentiel spectaculaire. Ce moment de bravoure est représentatif de l’ADN d’Uncharted, jusqu’à enchainer avec de l’inédit sous la forme d’un bateau pirate porter par des hélicoptères. Voilà qui donne envie d’avoir une manette entre les mains. Mais celui à qui a le plus réussi à reproduire cette impression d’enchainement toujours dans la démesure, c’est Fast and Furious 9. De la vitesse et de la fureur qui définissent bien Uncharted avec son lot de cascades improbables.

Difficile de faire plus fast food comme blockbuster, tout est dans son titre et sa numérotation. Neuvième opus d’une saga qui n’a plus grand-chose à voir avec le film original, c’est le summum de la commande que l’on va retirer au drive et que l’on mange directement dans la voiture. L’écran du salon comme pare-brise la télécommande en guise de frein à main, j’ai regardé ces différents personnages conduire en état d’ivresse. Car il faut en consommer des substances pour arriver à un scénario pareil. Malgré des références à Jour de tonnerre, la licence lorgne désormais vers Sharknado.
Il suffit de remplacer les requins par des voitures et de les envoyer dans l’espace pour un résultat similaire. Il y a aussi un côté GI Joe que ne renierait pas Stephen Sommers, et dont se réclame également Fast and Furious: Hobbs et Shaw. Buddy movie par excellence, le duo est confronté à une menace digne de celle de Cobra avec son méchant qui en fait des tonnes, et celui qui le contrôle en secret dans l’ombre. Mais ce spin-off vaut surtout pour son festival de punchlines digne de celle dont Chuck Norris fait l’objet.

Cet actioner décérébré affiche également son lot de guest star avec un caméo de Kevin Harts, éternel bro de Dwayne Johnson, et un petit rôle pour Ryan Reynolds. Une apparition qu’il doit à David Leitch, également réalisateur de Deadpool 2, et qui l’a d’ailleurs rappelé pour Bullet Train, juste pour un unique plan. Une blague qu’il faut voir comme une réponse à celle de Brad Pitt qui jouait l’homme invisible de la X-Force dans la deuxième aventure du mercenaire déjanté. Le temps d’écran est donc ici inversé pour les deux stars, pour une intrigue qui prend place à bord d’un train à grande vitesse. À très grande vitesse.
Les événements s’y enchainent à la même cadence. Il y a à boire et à manger dans cette voiture-bar qui s’étend d’un bout à l’autre. Entre les dialogues savoureux et les personnages tout droit sortis d’un film de Guy Ritchie ou de Robert Rodriguez, c’est du fun à l’état pur. Mais la mise en scène de David Leitch y est pour beaucoup dans ce trip vertigineux. Lui qui avait co-réalisé le premier John Wick, avec Chad Stahelski, semble avoir trouvé en Brad Pitt ce que son compère à vu en Keanu Reeves: son double. Guère étonnant puisqu’il a été sa doublure attitrée dans son passé de cascadeur.

Le cinéaste opère donc une fusion avec sa tête d’affiche pour proposer un vent de fraicheur sur le cinéma. C’est simple, lors de mon premier visionnage en salle l’été dernier, cette production était plus puissante que la clim. Le revoir m’a donné cette même impression d’être sur le quai d’une gare en prenant garde à ne pas me faire happer par la circulation ferroviaire. Alors certes, ces films sont aussi colorés que des glaces à l’eau, bourrés de colorants, mais je les ai revus en connaissance de cause. Ils sont pareils à des attractions dans une fête foraine, et peu importe si cela fait de moi un spectateur que l’on range dans la catégorie bon public, cela fait partie de ma cinéphilie.
CINÉMA
65 : la Terre d’avant / Evil Dead Rise

Sam Raimi n’est pas seulement un réalisateur. C’est aussi un producteur. Et contrairement à ses confrères qui utilisent leur nom comme argument commercial pour mieux masquer la médiocrité de leur production, Sam Raimi est souvent synonyme de qualité. Mais surtout, synonyme de visibilité pour des projets qui peinent à voir le jour. C’est le cas pour 65 : la Terre d’avant, un film de dinosaures sur un marché loin d’être saturé, mais déjà dominé par le cultissime Jurassic Park.
Même la franchise Jurassic World n’y est pas parvenue avec des budgets toujours plus impressionnants. C’est en partie à cause de cette escalade que dinosaure rime désormais avec blockbuster, sinon rien. Du coup, face à 65 : la Terre d’avant, il est tentant de se demander : est-ce que vous avez prévu des dinosaures dans votre film de dinosaures? Disons qu’il y en a au moins 65. Un nombre loin d’être aussi conséquent que ceux recensés dans le célèbre parc, mais tout à fait suffisant pour un simple survival.

De plus, le trailer était plutôt clair quant à l’ambiance, mais pas forcément sur le contexte. À l’issue de son visionnage, le flou persistait sur les raisons autour de cette aventure en milieu hostile. S’agissait-il d’un voyage temporel? D’une planète autre que la Terre où se trouvaient aussi des dinosaures? Une autre civilisation humaine ayant échoué sur Terre à l’ère des grands sauriens? Conscient de ce manque de clarté, un texte explicatif viendra ouvrir le long-métrage pour valider la dernière théorie.
Tout part donc de la planète Somaris, où un pilote nommé Mills sera contraint de quitter sa famille pour une mission d’exploration. Une mission de longue durée avec un gros salaire à la clé qui pourrait lui permettre de payer les soins de sa fille gravement malade. Mais la trajectoire de son vaisseau est détournée par un astéroïde et il échoue sur Terre. Parmi les passagers qu’il transportait, seule une petite fille du nom de Koa a survécu au crash. Ensemble, ils vont tenter de rejoindre une capsule de survie à des kilomètres de leur point de chute.

Entre les deux bien sûr, des dinosaures, mais pas que. L’astéroïde qui a dévié la course du vaisseau de Mills n’est autre que celui qui va mener à l’extinction de ces lézards géants. Le temps est donc compté et la durée du film va dans ce sens en affichant seulement 1h30 au compteur. C’est peu, mais suffisant pour développer un récit à travers des références que les fans du genre connaissent. En somme, The last of us pour le duo, After Earth pour la Terre à l’état sauvage, et Pitch Black pour la survie dans un environnement mortel.
Ainsi, cette production n’a jamais la prétention d’être un film à grand spectacle. Juste une honnête série B qui s’inscrit dans la même lignée que ses influences. Il en est de même pour sa tête d’affiche, Adam Driver, qui n’a rien de bankable. Même en arborant un look de cheveux long à la John Wick, il est loin d’avoir le charisme de Keanu Reeves. Mais il a la carrure grâce à son passé dans le corps des marines. Une expérience qui lui donne de la crédibilité dans ce rôle physique, mais aussi presque mutique.

Car même s’il a la responsabilité d’une petite fille dans son périple, la barrière de la langue les empêche de réellement communiquer. Ainsi, le scénario ne s’embarrasse pas de surexplication ou dialogues inutiles à base de punchlines. Une économie qui n’a finalement rien d’extraordinaire venant des auteurs du scénario de Sans un bruit. Ce qui parle le plus, c’est la poudre. Et pour la première fois, on peut voir des armes à feu faire mal à des dinosaures là où cela semblait juste les chatouiller dans d’autres productions.
Ce mélange entre un armement futuriste et des reptiles préhistoriques rappelle immédiatement le jeu vidéo Turok. Les scènes d’action sont dans ce même état d’esprit jusqu’au fameux boss de fin. Cette influence vidéoludique est d’ailleurs citée lors d’un affrontement vu par le prisme d’un moniteur holographique. Ne reste plus qu’à prendre la manette. Et aux commandes de cette mise en scène, Scott Becks et Bryan Woods sont plutôt efficaces. Même s’il semble évident que cette séquence en particulier est inspirée de The Suicide Squad (et de son combat qui se reflète dans le casque chromé de Peacemaker).
Du reste, la réalisation est assez classique pour un film qui tient ses promesses. Ni plus, ni moins. Un film qui a la saveur d’antan. D’avant. Avant, les blockbusters friqués au possible, mais dépourvus d’idées. Toutefois, avec le nom de Sam Raimi pour chapeauter le tout, il est impossible de ne pas se demander ce que cela aurait pu donner avec le célèbre réalisateur derrière la caméra. Une question qui ne se pose pas pour Evil Dead Rise puisque l’on connait déjà son style. Ce même style qui l’a rendu célèbre en faisant ses armes sur cette même franchise. Voir un autre cinéaste derrière la caméra est donc plus que bienvenue pour séduire une nouvelle génération.

Même si je fais partie de l’ancienne, j’étais trop jeune pour avoir vu la trilogie originale au cinéma, et j’ai regretté de ne pas m’être rendu en salle pour le remake de 2013. Ce dernier avait déjà enlevé Ash de l’équation, héros emblématique au point de gagner une mention dans le titre de l’excellente série Ash VS Evil Dead. Pour cette nouvelle monture, c’est la cabane dans les bois qui disparait au profit d’un immeuble. De quoi se demander si la licence n’est pas devenue un banal slasher en l’absence d’autant de symboles qui faisaient toute son identité.
Mais ça serait remettre en cause le don de Sam Raimi pour dénicher de nouveaux talents et dépoussiérer ce qu’il a créé il y a plus de 40 ans. Après Fede Alvarez, c’est donc Lee Cronin qui va jouer avec les codes d’Evil Dead, pour mieux les contourner. Il s’en amuse tellement que la cabane dans les bois ne sert de décor que pour le prologue, et pour ce qui est du plan censé représenté le mal en vue subjective, cela s’avère être un drone. Plutôt malin pour détourner les attentes et apporter du sang neuf. Et pas qu’un peu compte tenu des litres d’hémoglobine qui sont déversés durant la scène d’ouverture.

Une fois le titre dévoilé, d’une manière assez grandiloquente qui plus est, on sait que l’on va assister à un spectacle sans concession. En faisant le choix de délocaliser son intrigue dans un immeuble, le réalisateur et scénariste Lee Cronin propose un terrain de jeu inédit pour son reboot. En effet, ce n’est là ni une suite de la trilogie originale, ni une suite du remake, mais bien une nouvelle version mettant en scène de nouveaux personnages. Ici en l’occurrence, il s’agit de Beth qui va rendre visite à sa soeur et les enfants de celle-ci dans leur résidence.
Un tremblement de terre va venir en secouer les fondations et libérer le fameux Nécronomicon qui y était enfermé. Un macgufin qui permet de comprendre la tournure qu’est en train de prendre la saga. Une orientation proche de celle de Predator qui privilégie son antagoniste pour lui faire traverser les lieux et les époques. À partir de là, l’héroïne se mue en une Sarah Connor tandis que la Deadites fait office de Terminator. On peut aussi y voir une Ripley, accompagnée de Mewt, face à un Alien. Cette dernière comparaison est loin d’être gratuite au regard des monstres qui s’assemblent pour ne faire qu’un dans l’acte final.

Face à cette abomination digne de The thing, l’emblématique tronçonneuse est bien de la partie pour une fatality que ne renierait pas Mortal Kombat. C’est gore à souhait, toujours dans l’excès, mais rarement jusqu’à l’écoeurement. Le côté cartoon contrebalance ce déferlement de violence où la fragilité des corps est mise à rude épreuve. C’est simple, il se passe tellement de choses en 1h37, que j’ai eu l’impression que cela durait plus longtemps. En cela, Evil Dead Rise mérite largement sa place aux côtés des classiques qu’il cite ouvertement comme L’exorciste, ou encore Shining avec son ascenseur qui déverse des vagues de sang.
Ne reste plus qu’à Sam Raimi de surfer sur cette vague pour perpétuer cette trash attitude. Moins bien que le remake, mais trop différent pour être comparé, ces réinventions sont en train de surpasser les originaux à mes yeux. Ce qui rend l’attente d’un nouveau volet d’autant plus longue: le premier était daté de 2013, celui-ci en 2023. J’espère ne pas avoir à attendre 2033 pour retourner dans ce tourbillon écarlate. Mais si c’est aussi qualitatif, alors pourquoi pas?
LITTÉRATURE
La nuit des temps
Être un auteur reconnu est compliqué.
Être un auteur de science-fiction reconnu est très difficile.
Être un auteur de science-fiction reconnu en France relève de l’exploit.
Les écrivains qui exercent dans le genre de l’imaginaire n’ont jamais vraiment eu la cote dans l’hexagone. C’est un pays qui valorise bien plus la littérature classique. Même si aujourd’hui ces aprioris n’ont plus lieu d’être grâce des auteurs populaires comme Bernard Werber, Maxime Chattam, Mathias Malzieu et bien d’autres, c’était loin d’être gagné pour leurs prédécesseurs. Pourtant, l’un d’entre-eux a réussi à se faire une place de choix en devenant une référence: René Barjavel.
Ses publications s’étalent des années 40 à fin 80 et ont contribué à rendre respectable ce genre si méprisé par l’élite. De quoi attiser ma curiosité, et porter mon attention sur La nuit des temps pour découvrir son travail. Considéré comme un chef d’oeuvre, cet ouvrage était à l’origine un scénario destiné à être porté au cinéma. Mais devant le budget faramineux, cette histoire a été recyclée en roman. En ayant connaissance de ces informations, la déception n’en a été que plus grande.

Libéré de toute contrainte budgétaire, le récit aurait dû s’épanouir pour offrir une fresque gigantesque. Sauf qu’à aucun moment on ne ressent ce souffle épique. Si souffle il y a eu, c’est celui que j’ai poussé lors de ma lecture. Et c’était parmi les plus épiques que j’ai pu produire. Mais cette exaspération n’était pas forcément dirigée contre l’aspect science-fiction, mais plus le style de Barjavel. Ou en tout cas sa manière de présenter les choses, et son point de vue sur celles-ci.
Bien sûr, ce récit est à remettre dans le contexte de son époque, mais le découvrir aujourd’hui a de quoi faire réfléchir. Entre racisme et sexisme, il y a de quoi faire. Ces deux formes de discrimination prennent place dans un récit où un signal a été découvert en Antarctique. Des expéditions sont donc lancées pour aller jusqu’à sa source. S’ensuit une longue introduction où le récit prend des airs de poupées gigognes, jusqu’à rencontrer la dernière. Ou plutôt, les deux dernières, un homme et une femme, qui sont issus d’une ancienne civilisation.
Leurs successeurs se mettent donc en tête de les sortir de leur état comateux. Cela donne lieu à des échanges entre les différents intervenants, les différentes nations qui ont décidé de s’unir à l’occasion de cet événement retransmis dans le monde entier. Il en ressort des descriptions et des propos que l’on pourrait prendre pour une caricature: les jaunes, les noirs, les gris… Le malaise est palpable et rajoute un peu plus à la difficulté de continuer la lecture. D’autant plus que l’image de la femme n’est pas non plus respectée.
Et lorsque l’on a un personnage féminin au centre de l’attention, elle en prend pour son grade. Il est consternant de voir à quel point cette vision manichéenne a pu être considérée comme faisant partie du statu quo. C’est là le reflet d’une pensée qui n’a plus lieu d’être. Même si les chapitres sont assez courts, leur nombre assez conséquent n’atténue en rien le contenu cliché à souhait. Un roman qui ne pourrait assurément pas être édité à notre époque. Pour faire un parallèle avec l’histoire, je n’aurais pas dû écouter ce signal me poussant à exhumer ce livre de l’étagère sur laquelle il reposait, et de la couche de poussière qui le recouvrait.
COMICS
Nomen Omen tome 1 : Total Eclipse of the Heart, Nomen Omen tome 2 : Wicked Game, Nomen Omen tome 3 : As the World Falls Down
On juge souvent un livre à sa couverture. Pour les comics, ce jugement passe aussi par les illustrations. Et plus encore puisque le dessinateur n’est souvent pas le même entre la cover et les numéros à l’intérieur. Parfois c’est une agréable surprise, parfois c’est pire. Très souvent, c’est la seconde option. Quoi qu’il en soit, il suffit alors de faire défiler les pages pour se faire une idée du style général, et de si cela est susceptible de nous convenir. Une sorte de trailer qui reflète l’ambiance de l’histoire que l’on s’apprête à découvrir. En cela, la couverture du premier tome de Nomen Omen aura réussi à se démarquer de la masse sur les étalages.
Avec son fond vert électrique et son héroïne au torse transpercé, d’où sortent des mains cadavériques, difficile de ne pas vouloir en savoir plus. C’est là l’oeuvre de Jacopo Camigni qui s’occupera également des planches intérieures. À mi-chemin entre Greg Capullo et Gabriel Rodriguez, son trait m’a rappelé l’univers de Locke and Key, impression décuplée par l’aura de surnaturelle qui plane sur ce récit. Également responsable de la colorisation et de l’encrage, l’artiste déploiera des trésors d’inventivité pour donner une véritable identité au titre.

Mais ce parti pris graphique monochrome, agrémenté de quelques touches de couleurs très marquées, ne sera pas suffisant pour rentrer dans cette intrigue très confuse. On y suit Becky, une jeune adulte qui voit la vie en noir et blanc, littéralement. Ainsi, le fait d’avoir une couleur dominante dans les cases est justifié par l’histoire, et non par effet de style. Même si cela reste superbe. Mais le fond est loin d’égaler la forme. La narration est difficile d’accès et se retrouve parsemée d’ellipses. Non pas que cela soit un obstacle à la lecture, mais ça l’est lorsqu’il s’agit de l’introduction à un nouvel univers.
Partant sur des bases assez bancales, le tome 2 de Nomen Omen l’est tout autant. Mais à au moins l’avantage de laisser plus de place à la magie, et donc plus de planches délirantes où les couleurs donnent du relief à l’ensemble. Mais cette explosion de sorcellerie ne va pas sans explications avec un scénario bavard. Et donc des personnages qui le sont tout autant. Dès lors, les illustrations sont gâchées, trouées, par des bulles de dialogue, ou des encarts de narration, de part et d’autre. Les dessins y perdent en impact, tandis que l’histoire empiète sur son principal point fort.

Si il fallait faire une mise en abime de ce gâchis visuel, ça serait la couverture affichant un personnage au torse perforé. Un trou béant dans la poitrine donnant sur du vide. Cette illustration se trouve être une redite de la première couverture où Becky était elle aussi dans ce cas de figure. À ce propos, cette deuxième partie la verra s’entrainer pour récupérer son coeur. Je n’irais pas jusqu’à dire que c’est la raison pour laquelle cette histoire manque de passion, mais j’ai eu du mal à ressentir de l’empathie pour la galerie de protagonistes.
Restent quelques bonnes idées comme le smartphone qui permet de jeter des sorts. Un mélange des genres qui symbolise l’une des lois d’Arthur C. Clarke qui veut que toute technologie suffisamment avancée soit indiscernable de la magie. Le troisième et dernier tome de Nomen Omen continuera dans cette voie chère à l’urban fantasy. L’auteur Marco B. Bucci y conclura l’arc narratif de ces créations, tout en se laissant la possibilité d’un retour. C’est ce qu’il révèle dans la postface avec l’annonce d’une suite qui va changer de nom pour Arcadia volume 1: mad world.

Toujours inédit en France, cette suite ne me laisse pas pour autant indifférent malgré ma présente déception. Comme pour ces trois volumes, celui-ci se sert aussi du titre d’une musique en guise de sous-titre et l’équipe artistique semble inchangée. Même s’il faudra que je relise cette trilogie avant de m’y atteler, je ne peux nier avoir envie de retrouver la vision de Jacopo Camigni. Son style est énergique et lors de ce dernier tome, j’ai parfois eu la sensation de tourner les pages d’un comics Green Lantern avec la manifestation de la magie sous des formes vertes. Son talent ferait d’ailleurs des merveilles sur ce super-héros…
SÉRIES
Miss Marvel / She Hulk
Pour cette quatrième phase du MCU, les femmes sont à l’honneur. Black Widow a enfin eu son film solo, Mjolnir a choisi Jane Foster pour devenir Thor, le titre de Black Panther a échoué à Shuri, Wanda a été la première à s’émanciper sur une série Disney +, Loki s’est découvert une variante, Hawkeye va passer le flambeau à Kate Bishop… Cette mise en avant avait été préparé par la fin de la phase 3 qui voyait la Guêpe partager l’affiche avec Ant-man pour la suite de ses aventures, ainsi que Captain Marvel qui portait un long-métrage sur son seul nom.
Mais ce sont surtout ces moments dans Avengers : infinity war et Avengers : endgame, que l’on pourrait qualifier de Girl Power, qui ont ouvert la voie. Afin de continuer à fournir toujours plus de diversité dans leurs productions, Marvel Studios a donc adapté une autre super héroïne: Miss Marvel. Derrière ce pseudo se cache une ado prénommée Khamala Khan qui est fan de Captain Marvel. Ce qui est loin d’être mon cas. En tout cas, son film figure dans mon top comme étant l’un des plus mauvais du MCU. Peut-être même à la dernière place.

Autant dire qu’à partir de là, je n’avais pas beaucoup d’affinité avec cette nouvelle héroïne. Non seulement je ne partais pas sur de bonnes bases, mais cette série non plus en se reposant entièrement sur la continuité. Autant la série Moonknight était assez avare en connexion, au point de croire qu’elle était indépendante, autant Miss Marvel s’inscrit totalement dans la chronologie et ne pourrait pas exister sans cet univers partagé. Cette appartenance est symbolisée par l’Avengers Con, une convention célébrant les figures super-héroïques.
Si cet événement est l’occasion de faire des références à tout va au Marvel Cinematic Universe, la série puise surtout son inspiration dans un film d’animation: Spider-Man into the Spiderverse. En effet, Khamala va se rendre à l’Avengers Con, contre l’avis de ses parents, afin de participer à un concours de cosplay. Son accoutrement fait-main va alors l’accompagner dans ses débuts et la découverte de ses pouvoirs. Comme Miles Morales. Et comme lui et son costume bon marché, elle va tout faire pour se montrer digne de son idole.

Mais cette influence ne se limite pas au fond, à savoir l’iconisation d’un ado issu d’une minorité ethnique, la forme elle aussi tente une approche qui diffère de la charte graphique du MCU. Ainsi, mes doutes à propos de l’animation en surimpression de l’écran ne se limite pas au trailer. Des délires visuels que la version animée de l’homme-araignée a rendue populaire. C’est pop, frais, coloré, tout en étant dans la continuité du travail des réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah sur Bad Boys for Life, lequel avait déjà une utilisation assez poussée des couleurs.
Outre ces effets à la Scott Pilgrim Vs the World, ces colorants ne font pas illusion sur son scénario. C’est à peu de choses près la même structure que celle d’Alerte rouge: une fille pleine de vie qui s’amuse avec ses potes, une mère castratrice, un secret de famille autour d’un bracelet, les tantes de la famille, le beau gosse sur lequel flashe Khamala… Tout y est. Mais là où la production de Pixar allait à l’essentiel en rythmant son récit sur 1h30, les 6 épisodes de cette première saison ne font que ralentir l’intrigue.

Même si elle prend le temps d’installer une ambiance à la Spider-Man : Homecoming, avec un directeur d’école trop cool et drôle, sur fond de musique de The Weeknd, la série passe à côté de son sujet. Le thème de l’identité est au coeur du personnage de par son appartenance à la communauté musulmane. Loin de moi l’idée d’alimenter une polémique, il y avait de quoi développer une sous-intrigue explorant la manière dont sont perçu les super-héros américains à travers les autres religions. Notamment l’islam.
Marvel Studios n’en est pas à sa première interdiction de diffuser des films dans les pays arabes. En cause, des divergences quant à certains sujets qui relèvent du blasphème. Plus grossièrement, le mode de vie américain, et les icônes américaines qu’ils glorifient à travers des comics et des films, sont loin de correspondre à une vision du monde universelle. Au point d’être assimilé au diable par certains. De quoi ajouter de la complexité et de la dualité au personnage de Khamala Khan.

À la place, ce qui s’opposera surtout à elle, ce seront des Djinns. Elle sera aidée par son meilleur ami Bruno qui fera office de geek dans le fauteuil. Mais plus proche de Freddy Freeman dans Shazam!. Des éléments qui font de Miss Marvel une série inoffensive dans son traitement. Que ce soit dans ses easter eggs comme le symbole des 10 anneaux sur le sol d’un temple, ou la scène post-générique annonçant le film The Marvels, rien ne vient réellement relever le niveau. Comme l’impression de se retrouver devant un programme estampillé Disney Channel.
De quoi demander réclamation à Marvel. Sauf s’ils envoient leur avocate attitrée pour régler cette affaire: She Hulk : avocate. Si son alter ego Jennifer Walters demande des dommages et intérêts pour ses clients, son autre facette crée des dommages au sens propres. Avec l’une on obtient réparation, avec l’autre c’est la destruction. Surtout les murs, en l’occurrence le quatrième, celui qui fait office de frontière entre la fiction et la réalité. Ainsi, She Hulk s’adresse directement au spectateur comme Deadpool pouvait le faire.

Sachant que le mercenaire déjanté ne va pas tarder à débarquer dans le MCU, ça prépare le terrain pour ce type de fantaisie, et pourquoi pas une future rencontre. Mais cette mise en abime ne se fait pas qu’à travers la cassure du quatrième mur, cela s’exprime également par les dessins des tribunaux rappelant les comics. La série TV des années 80, mettant en scène Hulk en live pour la première fois, est elle aussi citée, et parodiée à travers son générique. Un aspect complètement méta qui met en relief les coulisses de cette production.
Cette prise de conscience passe par des remarques sur des effets spéciaux qui coutent cher, et donc à utiliser avec parcimonie. C’est d’autant plus ironique que lors de la sortie des épisodes, une polémique était en cours concernant les CGI. Les artistes de VFX s’étaient alors insurgés contre Marvel, les qualifiant de plus mauvais clients sur le marché. Sous tension et en période de crunch récurrente sur les différents projets, cela donne un éclairage assez révélateur sur leurs propos. Le résultat ne peut que leur donner raison lorsque l’on voit certains films au rendu visuel laissant à désirer.

Il faudrait être aveugle pour ne pas le remarquer. Même Daredevil pourrait voir cette qualité qui ne cesse de décliner. Ça tombe bien, il est aussi présent avec Charlie Cox de ce rôle qu’il tenait déjà dans la série éponyme. L’homme sans peur y arbore un costume vintage afin de créer une démarcation avec cette nouvelle incarnation. De quoi relancer le débat sur la canonicité des personnages de chez Netflix. Une chose qui sera surement clarifiée à l’occasion de la prochaine série Daredevil: Born again. Difficile de trouver un titre plus juste, tout en étant référentiel à souhait.
En plus du diable rouge, et jaune, Jennifer Walters pourra également compter sur son cousin Bruce Banner. Mark Ruffalo y fait plus office de parrain pour introduire ce personnage qui a été infecté par son sang. Là encore, il y a un autre niveau de lecture puisque Hulk ne peut plus apparaitre en solo pour des questions de droit. Le voir dans une série à caractère juridique à donc de quoi faire sourire. Sans pour autant que cela ne soit vraiment abordé. Néanmoins, She Hulk a la bonne idée de récupérer des éléments du reboot dont il a fait l’objet pour inaugurer la première phase du MCU.

On avait déjà pu voir l’Abomination dans Shang Chi et la légende des dix anneaux, et là c’est Emil Blonsky qui fait son retour. De quoi faire le lien avec cette séquence qui le voyait se confronter avec Wong. Lui aussi est de la partie. Un casting auquel va venir s’ajouter le trop rare Rhys Coiro, éternel Billy Walsh dans Entourage, le temps d’un épisode. À peine plus récurrent, le créateur de costume sur-mesure Luke Jacobson permet de voir les coulisses d’une vie de super-héros. J’espère le revoir dans d’autres productions de cet univers partagé.
Une chose est sûre, She Hulk y a gagné sa place. Avec cette première saison de 9 épisodes, en apparence indépendants de par leur caractère procédural, elle s’est rapidement imposée grâce à un ton unique. Contre toute attente, son origin story ainsi que la maitrise de ses pouvoirs sont expédiés pour mieux se concentrer sur ce qui lui donne sa particularité, à savoir la thématique judiciaire. Un mélange des genres que j’avais déjà adoré dans Angel et son cabinet d’avocats Wolfram & Hart. À ceci prêt qu’ici il ne s’agit pas de démons, mais de super-héros qui évoluent dans les locaux.

Tous ces ingrédients font que cette série me parle, en plus de parler littéralement au public avec ces regards caméra. Des clins d’oeil pas toujours subtils, ou loin d’être suffisant pour passer outre le design de Skaar, fils du géant vert, mais qui offre de l’originalité. Au final, pour une série sur une femme capable de soulever des tonnes, et d’en faire des tonnes, c’est peut-être l’une des séries les plus légères du MCU.
COURTS-MÉTRAGES
Batman : Strange days / Batman Beyond
Un anniversaire est toujours l’occasion de faire le point. De jeter un regard en arrière sur le chemin parcouru avant de se lancer vers de nouveaux horizons. C’est ce que DC Comics a offert au chevalier noir en 2014, à l’occasion de ses 75 ans, sous la forme de deux courts-métrages. Le premier, intitulé Batman: Strange Days, n’a rien à voir avec le film éponyme de Kathryn Bygelow puisqu’il met en scène un ennemi récurrent de la chauve-souris: Hugo Strange. Un invité de choix puisque ce vilain est apparu avant même l’iconique Joker ou la célèbre Catwoman.
Une ancienneté qui coïncide donc avec le passé de Batman pour une histoire qui se propose de revenir sur l’une de ses premières missions. Pour ce faire, le format adopte un visuel en noir et blanc qui apporte une atmosphère inquiétante. À cela, il faut ajouter un épais brouillard d’où émerge une animation et des designs signés Bruce Timm. L’artiste derrière la série animée Batman des années 90 ajoute donc une nouvelle pièce à la fresque qu’il bâtit sur cette icône. Son talent s’étale sur une durée de moins de 3 minutes ce qui est très court.
Tellement que l’on pourrait voir cela comme une bande-annonce au comics de Matt Wagner qui s’était lui aussi approprié cette histoire de l’âge d’or à travers Batman et les monstres. Ici, on en voit qu’un, et il s’agit de Solomon Grundy. Un adversaire de taille pour le chevalier noir, mais ce dernier n’est jamais autant mis à l’épreuve que lorsqu’il se bat contre lui-même. C’est que va proposer le second court-métrage Batman Beyond, qui est encore plus court que le premier. Bien évidemment, l’intrigue se situe dans la timeline où Bruce Wayne a rangé sa cape tandis que Terry McGinnis a repris le flambeau.
Mais ce n’est pas pour autant qu’il y verra plus clair quant à la raison de la présence d’autres Batman dans la Batcave. Au contraire, ce n’est qu’un prétexte à de l’action. Mais compte tenu de la durée, et malgré une mise en scène allant à l’essentiel, il est impossible de développer ce petit film. Pire encore, il suscite autant l’enthousiasme que la frustration lors de son final réunissant des Batmen en nombre. Des cyborgs issus des différentes incarnations du personnage: l’original, celui de la série animée, Beware, le déjanté d’Adam West, la version de Tim Burton, le Dark Knight Returns…
Mais aucune trace de celui de Nolan, ou même un premier aperçus de Ben Affleck en costume, en guise d’easter egg, alors que Batman V Superman s’apprêtait à être dévoilé à l’époque. Quoi qu’il en soit, ce travelling donne immédiatement envie d’en voir plus sous la forme d’un épisode à part entière. En l’état, ce segment ferait une bonne scène d’introduction avant d’enchainer sur le célèbre générique de la série animée. Hélas, c’est le fatidique générique de fin qui viendra conclure cette séquence. Cela reste tout de même un bel aperçu de la longévité du super-héros.