FOMO n’est pas un faux mot.
Il s’agit de l’acronyme pour Fear Of Missing Out.
C’est un terme qui a gagné en popularité durant le premier confinement pour refléter l’étrange comportement d’une partie de la population. Dont le mien. En effet, comme beaucoup, j’avais notamment peur de « rater » mon isolement si je n’utilisais pas ce temps limité à bon escient. Une crainte d’autant plus renforcée lorsque l’on a une forte tendance à la procrastination.
Pour la plupart, cela s’est traduit par une hyperconnexion afin d’être au courant du dernier événement en date pour profiter de la moindre interaction sociale. Pour moi, cela concerner aussi des sorties, mais des sorties cinéma, de comics, de jeux vidéo… Tous ces supports recèlent une quantité astronomique d’oeuvres que je m’efforce de relayer ici, à travers ce webzine.
D’où son nom.
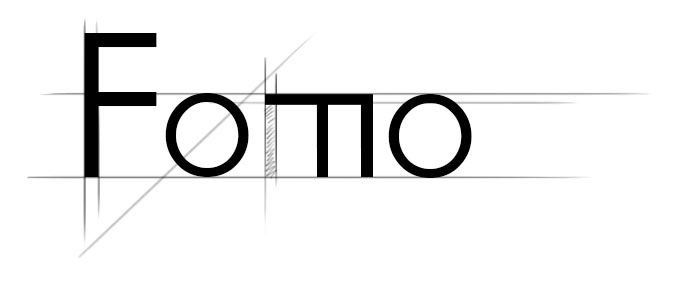
C’est là un moyen pour moi d’être raccord avec l’actualité, mais surtout avec ma consommation assez conséquente en la matière. Ce regroupement sous diverses catégories est donc la solution que j’ai trouvée, puisque je suis dans l’impossibilité de faire des articles pour chaque oeuvre. Quand bien même, chaque contenu ne mérite pas une publication. Par contre, d’autres oui, et c’est l’objet du disclaimer qui suit.
Disclaimer:
Certaines des critiques ci-dessous sont amenées à se développer dans des articles à part entière. Tout dépend de l’intérêt que je porte à l’oeuvre en question. Cela peut être par envie de donner à une découverte plus de visibilité, ou d’avoir à coeur d’analyser dans le détail un coup de coeur. Si l’une ou l’autre de ces conditions est au rendez-vous et que je dispose d’un point de vue qui n’a pas encore été abordé ailleurs, alors je me réserve le droit de lui consacrer une future publication pour revenir en long et en large sur le sujet. Il est alors possible que vous ayez une impression de déjà vu à la lecture. Et pour cause, je vois les critiques qui vont suivre comme de potentielles ébauches.
Mais ne vous y trompez pas, ici ça spoile à balles réeles alors gare aux révélations!
Si malgré cet avertissement vous ressentez le besoin de parcourir ce qui va suivre, alors c’est que vous êtes potentiellement atteint par le syndrome FOMO.
Bienvenue au club.
Dans le club de ceux qui préfèrent perdre quelques minutes à lire une critique, plutôt que de s’investir des heures durant dans une oeuvre qui pourrait potentiellement leur déplaire.
CINÉMA
Les gardiens de la galaxie volume 3 / Transformers: Rise of the beasts
Après un premier opus où Peter a surmonté le trauma de sa mère, un deuxième où il a fait connaissance avec son père, Les gardiens de la galaxie Volume 3 aurait dû en toute logique être centré sur l’enfant de Peter. Une manière d’assumer le rôle de parent maintenant qu’il a fait la paix avec les siens. Dès lors, faute d’avoir eu une progéniture dans le MCU (loin d’être aidé par la décision de revenir à une ancienne Gamora à l’occasion de Avengers Endgame), et en étant encore lui-même un enfant, Groot était tout désigné pour tenir ce rôle. Surtout au regard de son sacrifice dans le premier opus, sa renaissance et la relation père / fils adoptif qui s’est instaurée avec Peter tel que l’on a pu le voir dans une scène post-générique du volume 2.
Cela aurait permis de boucler la boucle de cette trilogie d’une manière satisfaisante. Du moins, selon moi. Mais mes espoirs d’une conclusion à la hauteur des précédents opus ont vite été balayés par les contraintes de l’univers partagé dont ces personnages font partie. En effet, à partir du moment où Peter a remis les pieds sur Terre pour la première fois à l’occasion d’Avengers Endgame, sans que cela ne soit exploité, j’y ai vu là une occasion manquée. C’était un moment qui aurait mérité plus de cérémonial, plus d’émotion. C’était là la fin de l’arc narratif de Quill, retournant là où tout a commencé pour lui. Et cela aurait dû se produire dans ce troisième volume.

À la place, il faudra ici se contenter de la Contre-Terre, sorte de copie de la Terre, mais avec des expérimentations signées par Le maitre de l’évolution. Rocket faisant partie de ses créations, c’est donc lui qui sera au centre de ce dernier opus. Sa backstory est ainsi développée à travers des flashbacks dont la gestion laisse à désirer. En effet, les précédents opus n’ont jamais eu recours à des retours en arrière dans leur narration toujours très énergique. Dès lors, le montage du film perd en rythme ce qu’il gagne en émotion. Et là, déjà que les précédents opus étaient très émotionnel, mais alors là on atteint un autre niveau dans le Marvel Cinematic Universe.
Autant le dire clairement, quiconque est sensible à la cause animale ne restera pas indifférent devant le passé de Rocket qui a subi des interventions chirurgicales, faisant de lui ce qu’il est aujourd’hui. Jusqu’à ce qu’il rencontre ceux avec qui il va former les Gardiens. Mais avant cela, le raton laveur s’était constitué une petite famille parmi ses voisins de cellule. Des animaux eux aussi maltraités et n’ayant rien à envier à la galerie des horreurs de la chambre de Sid dans Toy Story. Dans un même ordre d’idée, on retrouve pas mal de Woody, Buzz et les autres jouets d’Andy dans les interactions des différents membres des Gardiens de la galaxie. Et ce, jusque dans leur destin.

Ainsi, peu importe les designs délirants des créatures, des planètes et des vaisseaux, l’authenticité entre les personnages vaut plus que tous les effets spéciaux réunis. On a là un véritable esprit d’équipe. Il n’y a pas de longue discussion lorsque l’un des leurs est en danger, ou qu’il s’agit de prendre la bonne décision. En cela, c’est agréable de voir un film véhiculé de belles valeurs comme l’amitié d’une aussi manière aussi sincère. Et malgré les couches de maquillages sur leur visage, Drax, Mantis et Nebula sont peut-être les plus expressifs lorsqu’il s’agit de faire preuve d’émotion. On ne peut pas en dire autant de Gamora.
Ce personnage est le véritable problème du film car elle le condamne à des facilités scénaristiques. Notamment en termes d’exposition pour rappeler des faits antérieurs, comme ce qui est arrivé à l’autre Gamora au détour d’une conversation. En plus de perdre l’évolution du personnage, ce double de Gamora est d’autant plus embarrassant que les Gardiens de la galaxie ont toujours eu une place à part dans le MCU. C’était la seule franchise que l’on pouvait voir sans avoir suivi le reste de l’univers partagé de Marvel. Là, c’est obligatoire d’avoir vu Infinity War et Endgame. Et pour regarder ce diptyque, il faut avoir vu l’intégralité des productions pour y comprendre quelque chose.

Cela en fait donc l’opus le moins accessible pour ceux qui avaient échappé au marathon qu’est le Marvel Cinematic Universe. Malgré tout, l’identité de la franchise reste présente, que ce soit à travers les bons sentiments, l’humour qui fonctionne toujours aussi bien, les caméos (Nathan Fillon), ou les séquences d’action. Ces dernières sont toujours aussi réussies, notamment une à travers un plan séquence assez jouissif dans un couloir. Pour le reste, il y a de quoi ressentir quelques frissons devant des plans comme Peter et Groot dos à dos pour ouvrir le feu, ou voir ce dernier en mode Kaiju.
En guise de force d’opposition durant ces temps forts, on ne peut pas dire que les ennemis soient à la hauteur. Du moins, en termes de charisme. Le constat est flagrant concernant Adam Warlock qui est ici sous-exploité. La menace qu’il représente n’a rien de terrifiante. C’est d’autant plus regrettable que c’est sur lui que repose l’élément déclencheur du film. Or, il n’y a aucune mise en tension concernant sa présence, jusqu’à ce qu’il s’attaque à Rocket, devenu la cible des Souverains. Ces derniers, dirigés par Ayesha, sont également au service du Maitre de l’évolution qui les a créés et qui souhaite récupérer son rat(on laveur) de laboratoire.

Outre un aspect rappelant celui de Robocop sous le casque, le Maitre de l’évolution n’a rien de très attrayant visuellement. Au contraire du titre qu’il se donne, il marque une régression dans les antagonistes de la saga. Il manque ce petit quelque chose pour en faire un méchant mémorable. Surtout pour un opus censé être le dernier. Malgré ces défauts, cet épisode parvient à conserver le capital sympathie que les Gardiens ont gagné au fur et à mesure de leurs apparitions. Et puis, je sais aussi que les prochains revisionnages vont jouer dans l’appréciation de ce volume 3. Depuis le temps, avec les Gardiens, je connais la musique.
Ou plutôt, je ne la connais pas, mais elle rentre vite dans la tête lorsque l’on écoute la bande originale en boucle. Au premier abord, la playlist n’offrait pas de chansons aussi marquantes que les précédentes, puis après quelques écoutes, je peux déjà dire que certaines d’entre elles figurent parmi les meilleures. Notamment celles qui illustrent les trailers, et donnent une autre dimension aux images. À ce propos, les différentes bandes-annonces nous vendaient une potentielle mort dans les rangs des Gardiens. Impression renforcée par la perte de Groot dans le premier, et Youndu dans le deuxième.

Ici, tout indiquer que Rocket allait y passer. En tant que point final, cela aurait fait sens. Mais c’était soit trop attendu, soit trop facile. Côté coulisses, il n’y avait pas vraiment d’intérêt à faire mourir un personnage en image de synthèse, contrairement à un acteur de chair et d’os qui pourrait être lié à une polémique, demander un plus gros salaire, ou vouloir trouver une porte sortie du MCU pour orienter sa carrière vers autre chose. Aucune de ses possibilités n’a été choisie et pourtant, cette résolution n’en demeure pas moins triste. Et satisfaisante, dans le sens où chacun obtient ce qu’il souhaitait après avoir enduré tant d’épreuves.
Même si cela marque la fin des Gardiens de la galaxie, en tout cas pour la composition de cette équipe, la fin du générique nous gratifie d’un « Star Lord reviendra ». S’il devait s’agir d’une aventure en solo, j’espère que cela sera dans la lignée du comics Old Man Quill. En tout cas, une chose est sûre, c’est que James Gunn ne reviendra pas. Et c’est déjà une chance qu’il ait pu terminer son travail. En effet, Disney l’avait viré après avoir découvert des blagues de mauvais gout sur son compte Twitter. Son éviction lui avait alors permis de mettre un pied chez DC pour mettre en boite The Suicide Squad, avant d’être réintégré.

Durant ce laps de temps, Marvel s’était mis en quête d’un autre réalisateur, jusqu’à jeter son dévolu sur Travis Knight. Le réalisateur est notamment connu pour avoir mis en scène Bumblebee, sous forte influence des Gardiens de la galaxie. En effet, ce spin-off / préquelle avait tenté de surfer sur ce succès à grand renfort de tubes pop. Il faut dire que, comme il ne s’exprime que par l’intermédiaire d’une radio, Bumblebee était le personnage rêvé pour justifier cette orientation musicale. Mais l’utilisation de la playlist manquait souvent de contexte pour ne pas être une manoeuvre opportuniste.
Marvel est donc revenu sur sa décision en faisant revenir James Gunn, véritable gardien de la franchise. Par contre, on ne peut pas en dire autant de Michael Bay pour les Transformers. Au contraire, le cinéaste est parti de son plein gré, même si la saga reste tailler sur-mesure pour son cinéma. Il a donc cédé sa place à Travis Knight, puis à Steven Caple Jr. pour Transformers: Rise of the beasts. Et comme pour son prédécesseur, ce nouveau réalisateur ne parviendra pas à reproduire la démesure spectaculaire de Michael Bay.

Pourtant, j’avais beaucoup aimé sa précédente réalisation, Creed 2, et il était permis de s’attendre à quelque chose d’au moins aussi énergique. Ce septième opus de Transformers en est à l’opposé. Tout y est plat et l’on ne ressent aucune dimension cinématographique. Quant au fait de situer l’intrigue en 1994, ce n’est là que pour susciter la nostalgie. Ça n’est qu’un prétexte puisqu’à bien y regarder, l’histoire pourrait se passer n’importe quand. Et avec n’importe qui. En l’occurrence ici, il s’agit de Noah Diaz qui cède aux sirènes de la délinquance afin de subvenir au besoin de son frère malade.
Puis ce sont les sirènes de police qui vont se mettre à sa poursuite lorsqu’il va dérober une Porsche, qui bien sûr n’en est pas vraiment une. Il s’agit de l’Autobot Mirage qui va l’emmener jusqu’à Optimus, suite à un appel au rassemblement. Il va donc se retrouver mêler à une quête pour retrouver une clé de transdistortion permettant de retourner sur Cybertron. Sauf que cette clé est également convoitée par les Terrorcons pour le compte de leur maitre: Unicron. Sorte de Galactus version Transformers, ce n’est ni plus ni moins qu’un dévoreur de planète.

La menace est donc de grande ampleur, et pour en venir à bout, les Autobots pourront compter sur les Maximals. Si les premiers sont basés sur des modèles de véhicules, ces derniers se réclament quant à eux des animaux. Cela donne des designs étranges à base de plumes et de poils. Même s’il s’agit d’une manière pour eux de se camoufler lorsqu’ils sont sous leur forme animale, cela reste moins cohérent qu’un robot se transformant en engin motorisé. Mais ce n’est là qu’un détail qui appartient au lore des Transformers.
Cette mythologie va d’ailleurs se retrouver mêlée à celle des GI Joe à en croire la scène post-générique. Une idée qui date du premier Transformers, avant d’être abandonnée, et qui est ici recyclée pour créer un nouvel univers étendu. À voir comment ces deux franchises de jouet vont se mêler. En tout cas, il faut bien plus que l’annonce d’un crossover pour faire un bon film. Transformers: rise of the Beasts est loin d’en être un. Il n’est même pas un bon divertissement, ni même un blockbuster bête et méchant.

C’est là une production ennuyeuse, et qui plus est longue en termes de ressenti alors qu’elle fait moins de deux heures. Les seuls moments qui suscitent de l’attention, c’est lorsque l’on a un air de déjà vu et que l’on se rend compte qu’il y a des plans entiers pompés sur le premier Iron Man. Le savoir-faire en moins. Même conclusion pour MC Solaar à la BO avec son titre Tout se transforme, loin d’être à la hauteur de son succès passé Les temps changent. Finalement, ce septième Transformers est aussi daté que l’époque à laquelle il se déroule. Et encore, certains films des nineties ont mieux vieilli.
COURT MÉTRAGE
Batman VS Darth Vader
D’une certaine manière, Bruce et Anakin ont été recrutés par la même personne. Même si l’un a été choisi par Ra’s Al Ghul et l’autre par Qui Gonn Jinn, ces deux personnages ont été incarnés par Liam Neeson. Un acteur en qui l’on peut donc voir une figure d’autorité, selon le camp dans lequel il officie. Cela n’a pas empêché ses disciples d’aller à contre-courant de leur destinée. Ainsi, l’un a dompté sa peur, controlé sa colère et tiré un trait sur la vengeance pour se tourner vers la justice, tandis que l’autre a fait le chemin inverse en succombant peu à peu à ses sentiments destructeurs.
Bien qu’issues d’univers complètement différent, ces deux icônes de la pop culture, que sont Batman et Dark Vador, étaient faites pour se rencontrer. Mais surtout s’affronter. Le Dark Knight contre Dark Vador. C’est ce que propose le collectif Bat in the Sun, habitué des crossovers improbables. Mais pas pour autant incohérent. Au contraire, plus qu’un simple prétexte servant à un règlement de compte, leur background respectif est ici parfaitement utilisé. Cela prend la forme d’un texte déroulant dans le plus pur style Star Wars, et mentionnant rien de moins que la capture de Superman par Boba Fett.
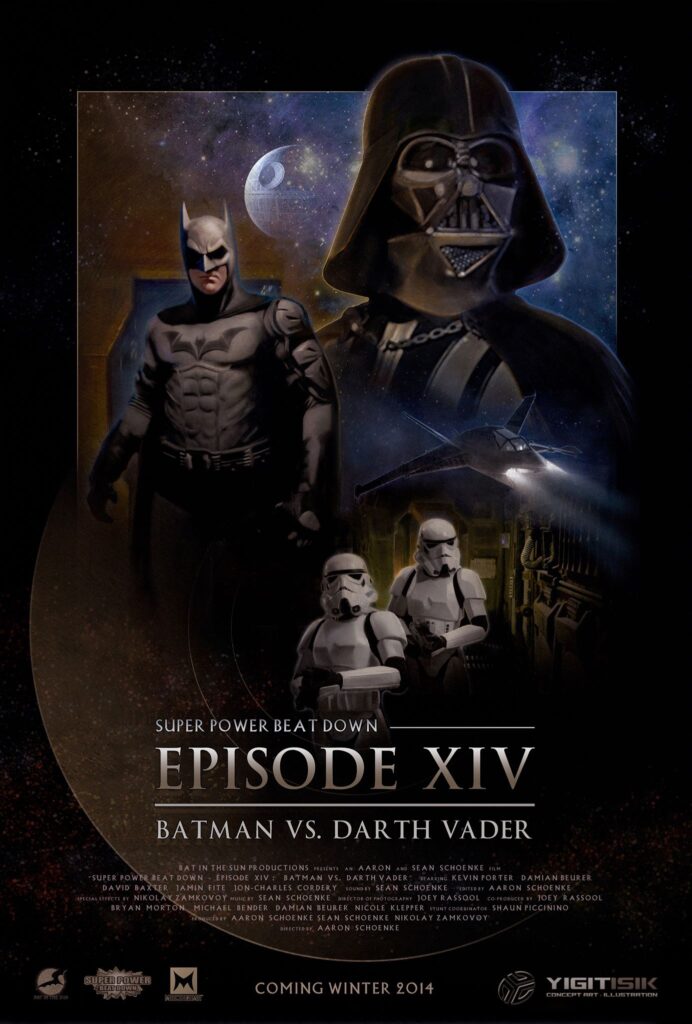
Pour capturer sa proie, le célèbre chasseur de prime a usé d’un sabre laser en kryptonite. Voilà qui est original, en plus d’être cohérent avec les deux mythologies, puisque les sabres laser tirent leur énergie d’un cristal. Mais plus que ce détail, c’est cette scène que j’aurais aimé voir. En attendant, c’est un contexte suffisant pour justifier que Batman fasse la route en Batwing pour secourir l’homme d’acier retenu prisonnier dans l’étoile de la mort. En contact avec Oracle, l’homme chauve-souris se fraye alors un chemin dans les couloirs de la station jusqu’à croiser le Jedi déchu.
S’ensuit un combat où tous les coups sont permis, particulièrement pour Batman qui use de son intellect et de ses gadgets pour avoir une chance de l’emporter. Et même si c’est celui de Christopher Nolan qui est cité en introduction, et qui donc a été entrainé par Ra’s Al Ghul, c’est plutôt celui de la saga Arkham qui est ici à l’honneur. Pour preuve son design ainsi que son moniteur holographique sur l’avant-bras et ses gantelets électrifiés. Faute de pouvoir faire usage de la Force, il ira jusqu’à bloquer son système respiratoire pour voir le dessus sur son adversaire.
Anakin se mettra alors en mode Qualrish dans Avatar en se mettant en apnée tout en poursuivant le combat. On a là un Vador dans la lignée de celui de Rogue One et de sa célèbre séquence de fin. Un couloir de la mort qui sert ici de cadre à un duel au sabre laser. Et il faut avouer que voir Batman manier la célèbre lame est plutôt inédit. Mais quitte à être à armes égales, je l’aurais bien vu endosser une de ces célèbres armures, comme celle du comics The Dark Knight Returns par exemple. Peut-être à l’occasion d’un deuxième round.
En tout cas, cela ne sera possible que si Bat in the Sun utilise la fin alternative. Je la trouve bien plus réussie que l’originale, car moins abrupte, en plus de faire une boucle avec le texte déroulant d’ouverture. Quoi qu’il en soit, ce fan film reste un exemple de crossover, tout en respectant les deux univers. On retrouve les transitions à la Star Wars pour passer d’une scène à une autre, ainsi que des répliques cultes « That’s no moon » ou « I know ». DC n’est pas en reste avec la mention d’Apokolips ou la kryptonite, qui font que l’on croit à la fusion de ces deux univers. Bien plus que dans certains comics dont le budget est illimité. Mais les idées très limitées.
LITTÉRATURE
Le journal perdu d’Indiana Jones
À l’occasion de la sortie du cinquième opus, qui explore pour la première fois le concept du voyage dans le temps, j’ai décidé d’en faire moi-même un. Pour cela, point de cadran de la destinée, juste Le journal perdu d’Indiana Jones. Cet ouvrage se propose de revenir sur la quadrilogie, sous couvert de mise en abime. D’emblée, ce carnet m’a fait penser à celui de Nathan Drake dans les jeux vidéo de la saga Uncharted. À ceci prêt que l’on ne suit pas ici l’ancêtre de Nate, mais l’ancêtre des archéologues.
Une nuance de taille lorsque l’on sait qu’Indy a inspiré bien des vocations parmi les chasseurs de trésors de la pop culture. Il faut donc rendre à César ce qui appartient à César. Sauf si sa place est dans un musée. Et l’on ne peut pas en dire autant de ce livre qui s’impose comme un objet mercantile de plus. Dommage, la franchise Indiana Jones ne possède pas tant que ça de produits dérivés. Il est donc regrettable de voir le peu de tentatives être de piètre qualité. Mais surtout, sans intérêt.
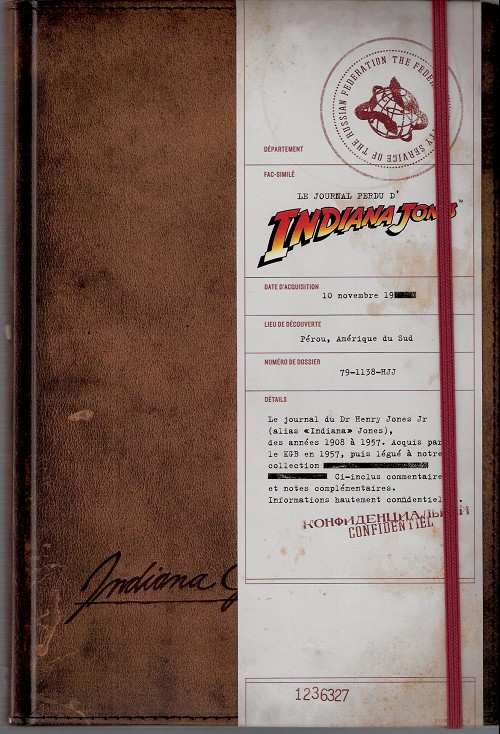
Car au-delà d’être une rétrospective des aventures d’Indy, ce livre ne propose rien de vraiment inédit. Dans la même lignée, Fringe: les notes de Septembre avait au moins le mérite de proposer un point de vue différent sur la série, puisque vu depuis le regard d’un observateur. Ici, c’est le point de vue du docteur Jones, exactement comme dans les films. On peut toutefois noter l’intrusion de Demie-lune entre ces pages qui s’amuse à y faire des dessins. Totalement raccord avec l’espièglerie du personnage. Plus travailler, on retrouve également des illustrations faites par le possesseur du carnet.
Un carnet qui n’est plus en sa possession, mais entre les mains des Russes suite au Royaume du crâne de cristal. Leurs services secrets y ont donc accolé des Post-its ce qui apporte une touche de réalisme à cette relique. L’auteur de ces pages a également eu le soin d’y faire quelques fautes lors de ces jeunes années où ils entretenaient ce carnet offert par son paternel. Une période qui aurait mérité d’être étoffée avec des anecdotes tirées de la série Les aventures du jeune Indiana Jones. Mis à part quelques allusions, les créateurs derrière cet ouvrage se cantonneront aux films.
À défaut, ils ont au moins le mérite de replacer les épisodes dans leur chronologie, à savoir le fait que Le temple maudit est une préquelle aux Aventuriers de l’arche perdue. Idem pour le flashback en ouverture de La dernière croisade avec un croquis du chasseur de trésor qui lui léguera son célèbre chapeau. Des illustrations qui s’intègrent plutôt bien à l’ensemble, contrairement aux collages de photographies. Ces clichés sont le résultat de montage parfois grossier pour y coller la tête d’un acteur par-dessus.

Entre autres documents annexes, il y a également une correspondance avec Lawrence d’Arabie, profitant ainsi de l’Histoire avec un H majuscule pour ancrer la mythologie d’Indiana Jones dans la réalité. Ce carnet s’efforce donc d’être le plus tangible possible, au point d’avoir sa place dans le fameux hangar à la fin du premier film. Un souci du détail qui va jusque dans le fait d’avoir déchiré des pages. Mais il y avait tellement plus à faire. Outre l’absence de références aux jeux vidéo, aux romans et aux bandes dessinées qui ont offert d’autres aventures, même si tout n’est pas canonique, ce carnet manque cruellement de créativité.
En effet, il est regrettable de ne pas avoir permis au lecteur de voir ce qui était noté sur une page manquante en posant une feuille par-dessus la suivante et en hachurant celle-ci avec un crayon. Un message caché aurait pu y être découvert. Dans un même ordre d’idée, il y avait également l’écriture à l’encre invisible. Une lumière spéciale aurait alors permis de la décrypter. Et je ne parle pas des symboles, et autres hiéroglyphes qui auraient permis de décoder des énigmes, en donnant accès à des infos supplémentaires sur Indy.
C’était là surement quelque chose de trop complexe à faire en termes d’édition, mais totalement en accord avec l’esprit de cet archéologue. Il est donc navrant de ne pas avoir été immergé plus que ça dans cette lecture. Même la blague en forme d’allusion à la scène du frigo dans le quatrième opus ne viendra pas masquer cette déception. Fort heureusement, ce ne fut que de courte durée puisque le temps de lecture est relativement rapide. Il n’y a définitivement rien à gagner dans ce journal perdu.
FILMS
Space Jam / Space Jam : nouvelle ère
Certains ont grandi avec Qui veut la peau de Roger Rabbit, moi c’était avec Space Jam. Et si mes souvenirs sont bons, c’est surement le premier film que j’ai vu au cinéma. Même s’il n’a pas bénéficié du savoir-faire de Robert Zemeckis à la réalisation, j’avais vu ce film avec des yeux d’enfants. C’est à dire complètement halluciné par la rencontre entre l’animation et des prises de vue en live. Le revoir maintenant avec un regard plus adulte, mais toujours avec mon âme d’enfant, n’a pas été sans appréhension.

Premier constat : c’est un film à la gloire de Michael Jordan. Et si dans l’histoire le basketteur se reconvertit en joueur de baseball, dans les coulisses c’est donc en tant qu’acteur qu’il tente sa chance. Avec autant de succès que son changement de sport. C’est-à-dire avec difficulté. Mais à sa décharge, il faut avouer que jouer avec des toons est loin d’être une partie de plaisir. Faute de pouvoir s’adresser à autre chose que des repères sur un tournage en fond vert, son interprétation en souffre forcément. Les acteurs de la prélogie Star Wars en savent quelque chose.
Mais si son jeu d’acteur est loin d’être performant, son jeu au basket est toujours aussi fluide et aérien. Ses interactions avec les looney toons s’intègrent plutôt bien à l’écran, et les gags de ces derniers sont toujours aussi hilarant même des années plus tard. Le design des basketteurs démoniaque, stylé et agressif, a également plutôt bien vécu le passage du temps. Ce qui l’est moins, c’est la sous-intrigue qui a conduit à optimiser leurs capacités, à savoir celle où 5 basketteurs se font voler leur talent. Leurs scènes s’insèrent assez mal dans le montage.

À défaut, ces séquences auraient mérité d’être coupées pour être remplacées par des phases d’entrainement. Car oui, il n’y en a aucune. Un comble pour un film basé sur un sport. Mais dans son équipe, Michael Jordan pourra également compter sur Bill Murray. Toujours égal à lui-même, cet acteur est vraiment un toons humain. Un peu dans la lignée de Jim Carrey. C’est d’ailleurs à se demander pourquoi ce dernier n’a jamais partagé l’affiche avec ces personnages animés, lui qui a puisé son inspiration dans leur gestuelle si élastique.
Une occasion manquée donc, tout comme celle de partir sur un autre sport pour la suite. En effet, la Warner avait envisagé de décliner le concept autour du golf avec Tyger Wood en tête d’affiche, ou encore le skate avec Tony Hawk. Cette dernière proposition semblait la plus intéressante à explorer. Mais finalement, c’est un retour au basket qui a été retenu avec Lebron James dans Space Jam : nouvelle ère. Une suite dans la lignée de ce qui a été fait avec Jumanji version The Rock. D’ailleurs, le studio aurait mieux fait de relancer cette franchise avec Dwayne Johnson pour faire entrer les Looney Toons dans le monde du catch. Succès assuré.

En lieu et place, le studio a préféré miser sur son propre catalogue. Ainsi, on se retrouve à visiter les franchises de la Warner Bros, comme dans Ready Player One. L’occasion de voir des reconstitutions de films cultes comme Mad Max Fury Road, mais avec des toons. Un aspect méta qui préfigurera la thématique principale de Matrix Ressurections, du même studio, intelligence artificielle à l’appui. Nommée Al-G Rhythm et sous les traits de Don Cheadle, cet algorithme va mettre au point le programme Warner 3000 visant à faire de Lebron James une star de l’animation.
Mais celui-ci n’approuvant pas le projet, cela a pour effet de vexer l’IA qui le transfert dans son monde et fait prisonnier son fils. Des motivations un peu faibles, pour ne pas dire ridicules, pour l’antagoniste de cette histoire. À cela, il faut ajouter un Lebron James complètement cartoonisé. Dès lors, on perd l’essence du premier Space Jam qui était un mélange de live et d’animation. On retrouve un peu de cet esprit lors du match final, mais cette partie de basket est bien trop parasitée par des effets à la Fortnite. En plus de modéliser les toons en image de synthèse, et non en 2D.

Mais il faut bien avoir à l’esprit que ce long-métrage ne s’adresse plus à la même génération d’enfant. Toutefois, je n’ai pas pu m’empêcher de me demander si j’aurais aimé ce film étant gamin. Sans doute. Même si cela reste sujet à débat puisque le problème de cette suite tardive, c’est que les Looney Toons ne sont plus dans l’air du temps. J’ignore ce qu’il en est aux États-Unis, mais ici il n’y a plus Ça cartoon sur Canal + pour les populariser. Les icônes des jeunes ont changé, c’est un fait. Pour autant, au-delà de l’esthétique, je ne suis pas sûr qu’ils saisissent toutes les références.
Et il y en a, que ce soit en arrière-plan, avec une flopée de personnages issus de différents univers, qu’au premier plan. Je pense notamment à la bonne blague sur Michael (B.) Jordan qui est appelé à la rescousse. Sa présence est d’autant plus logique lorsque l’on sait que c’est Ryan Coogler qui est à la production, lui qui avait réalisé Creed avec l’acteur dans le rôle-titre. Mais cela n’est pas suffisant pour faire une bonne histoire. Il ne suffit pas de mettre une Game Boy à l’écran pour faire vibrer la corde nostalgique des fans de l’époque, ou de mettre des images d’archives de Lebron James pour rameuter son public. Tout comme la ressurection de Bugs Bunny dans le climax, cette production n’a aucune justification.
COMICS
Original Sin / Siège / Dark Ages
Avant, les crossovers étaient des événements éditoriaux exceptionnels. Une rencontre au sommet entre différents personnages pour affronter une menace commune, avant de les voir reprendre leur route respective. Désormais, au rythme de plusieurs events annuel, ce type de rencontre n’a plus rien d’événementiel. C’est devenu la norme dans le paysage des comic books. Difficile donc de s’extasier devant des annonces nous promettant un nouveau statu quo, des morts en pagailles et autres révélations.
Néanmoins, ces réunions à répétition impactent les aventures solos des personnages, univers partagé oblige. Je me suis donc mis à jour, à commencer par Original Sin. On y découvre Uatu, le gardien, à travers des planches très old school. Un être mystérieux dont le rôle est d’observer le multivers, sans intervenir. Mais l’on apprend que tous les 3 ans, et ce durant 42 minutes, cet être omniscient entre dans un état de transe. C’est par cette fenêtre de tir que des cambrioleurs s’introduisent chez lui pour lui dérober quelque chose…

Un angle mort dans son champ de vision qui provoquera sa propre mort. Ainsi, on découvre son cadavre sur une superbe double page. Deux pages où il manque deux choses: les yeux du Gardien. Des globes oculaires qui ont été témoin de bien des secrets concernant ceux qui arrivent sur la scène de crime: Wolverine, Captain America, Black Widow, Thor et Nick Fury. Bien d’autres viendront se joindre à cette enquête comme Spider-Man, La chose, Doctor Strange, le Punisher…
Mais c’est surtout Nova, le fils de Richard Riders qui a donc pris sa relève, qui est mis en avant pour avoir pu rencontrer Uatu. Son comportement est un peu similaire au Peter Parker du MCU: trop content d’être un héros, en admiration devant les Avengers, toujours en train de poser 1000 questions… Et il y a de quoi s’en poser tant l’histoire est confuse malgré un point de départ intriguant. Je retiendrais juste quelques belles illustrations, notamment une de Strange dans une dimension tentaculaire.

Pour le reste, c’est beaucoup trop bavard quand ça devrait être silencieux, et trop inaudible quand on voudrait en savoir plus. Je fais notamment allusion à la scène où Nick Fury murmure quelque chose à l’oreille de Thor, ce qui lui fait perdre ses moyens. Mais surtout son marteau qui ne le reconnait plus comme étant digne en allant s’échouer sur la Lune. Là où le trouvera Jane Foster. Pour avoir lu le cycle sur Mighty Thor, cela m’a permis d’éclaircir les circonstances ayant amené Mjolnir entre les mains de la scientifique.
Et puisqu’il est question de Thor, Siège se propose d’envahir Asgard. Derrière cette initiative se cache Norman Osborn. Et derrière Norman Osborn se cache Loki qui le manipule pour parvenir à ses fins. Ainsi, le dieu de la malice utilise la folie d’Osborn, alias le bouffon vert, pour le convaincre qu’il a tout à gagner à déclarer la guerre aux Asgardiens. Pour cela, il n’aura pas à emprunter le Bifrost puisqu’Asgard est désormais une cité volante au-dessus de l’Oklahoma.

Désormais à la tête de sa propre équipe d’Avengers en officiant sous le nom d’Iron Patriot, Norman va donc s’attirer les foudres des dieux. Un point de départ assez simple qui ne cache même pas le fait de vouloir reproduire l’événement qui a conduit à Civil War, afin d’avoir une bonne raison de déclencher les hostilités. Brian Michael Bendis aura beau parasiter son récit principal avec des numéros annexes, cela ne changera rien à cette impression de déjà vu. En plus de perdre en fluidité dans la narration.
Finalement, cette histoire ne vaut que pour le talent d’Olivier Coipel à la partie graphique. Du moins, juste sur l’histoire principale. Le reste est dispensable. Comme souvent, pour donner une raison d’être à cet event, une mort va venir clôturer cette histoire. Une mort temporaire, comme il y en a tant dans les comics. À contrario, les morts sont bien définitives dans Dark Ages. Il faut dire que l’on a là un expert en la matière avec la présence de Tom Taylor au scénario.
L’auteur n’a plus rien à prouver en la matière puisqu’il a fait une hécatombe chez DC Comics avec les sagas Injustice et DCeased. Ces deux titres ont en commun une réalité parallèle dans laquelle le scénariste peut se permettre tout et n’importe quoi. Et ce, sans soucier de la continuité officielle. Chez la Distinguée Concurrence on appelle ça un Elseworld, à La maison des idées, c’est un What if. C’est donc dans cette dernière catégorie qu’il va inscrire son récit en faisant rentrer les personnages de l’éditeur dans un âge de ténèbres.

Tout commence avec une ouverture rappelant le climax du film Les éternels. Cela donne une idée de l’ampleur de la menace. En effet, une divinité, ici le Décréateur, est enfermée au centre de la Terre et tente de s’en échapper. Pour stopper sa progression, Doctor Strange n’a alors d’autres choix que de le priver de la source d’énergie dont il se nourrit pour sortir de son cocon, à savoir l’électricité. C’est ainsi que les habitants de la Terre se retrouvent dans un monde où la technologie est obsolète, faute de pouvoir l’alimenter.
Pour l’occasion, la galerie de personnages de chez Marvel va devoir s’adapter à ce nouveau statu quo, et cela se voit à travers de nouveaux designs. Plus Steampunk, retour à une autre forme d’énergie oblige, ils profitent tous du talent de Iban Coello pour les magnifier. De plus, chacun d’entre eux est mis en valeur dans des planches extrêmement dynamiques. Ça fuse de partout, les cases s’enchainent tout en restant parfaitement lisibles. Et cela s’accélère encore plus lorsqu’Apocalypse révèle vouloir transférer son esprit dans le corps du Décréateur… On n’en attendait pas moins de sa part.

Par contre, j’en attendais plus de celle de Tom Taylor. En effet, la seule chose qui soit regrettable avec Dark Ages, c’est qu’il s’agisse d’un one shot. Pas tant que j’aurais aimé avoir une suite, disons plutôt que j’aurais préféré voir cette histoire s’étaler sur plusieurs tomes. Il faut dire que l’auteur m’a habitué aux sagas sur le long terme en explorant ses personnages et le monde dans lequel il les fait évoluer. Mais au moins, cette succession de temps fort permet à cette aventure d’avoir un rythme sans temps mort. Un blockbuster qui se suffit à lui-même.
SÉRIES
Powers saison 1 et 2
Il y a des adaptations qui donnent envie de découvrir l’oeuvre d’origine, et puis il y a celles qui nous donnent envie de les fuir. Powers fait partie de cette dernière catégorie. À l’origine, il s’agit d’un comics créé par Brian Michael Bendis, un grand nom du milieu, connu pour avoir lancé et écrit des centaines de numéros de Ultimate Spider-Man. Sa plume a permis de faire entrer le personnage dans l’ère moderne. Par contre, lorsqu’il s’agit d’une de ses propres créations, l’auteur semble avoir un peu plus de difficulté à captiver.
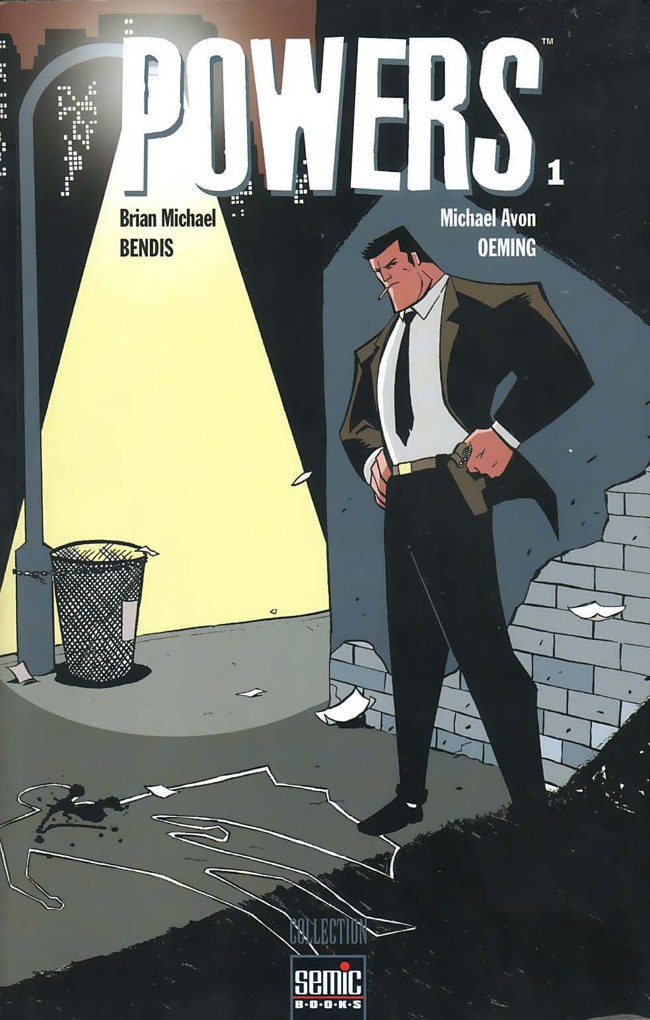
Pourtant, le postulat de départ a de quoi susciter l’intérêt avec un monde où les super-héros font partie du quotidien. Tellement, qu’une police a été créée pour s’occuper d’enquête impliquant ceux disposant de pouvoirs. Une division spéciale du nom de Powers dont fait partie l’inspecteur Christian Walker qui va se voir attribuer une nouvelle équipière: Deena Pilgrim. Un duo de flic qui n’échappe pas aux clichés du genre puisque tous les opposent. Et pour cause, avant d’entrer dans la police, Walker était lui-même un super-héros.
Il officiait sous le pseudo de Diamond, et ne fait qu’éprouver de la frustration à l’idée d’être redevenu un simple humain. Sharlto Copley, révélé dans District 9, incarne plutôt bien ce flic désabusé, même si Neil Blompkamp n’aurait pas été de trop pour le diriger. Et diriger cette série par la même occasion. En effet, le côté irrévérencieux n’est pas aussi impactant que prévu. Pourtant, les insultes sont là, il y a bien quelques effets gore, mais c’est loin d’être trash. Surtout après avoir vu The Boys dans le même genre.

Même avec seulement 10 épisodes au compteur, la série est d’une lenteur dans son développement. La saison 2 est son changement de générique ne changeront rien à l’affaire. Pas plus que la présence de Michael Madsen en guise de bad boy supplémentaire au casting. Non, les effets spéciaux sont toujours à côté de la plaque et l’actrice qui incarne Deena Pilgrim est toujours aussi désagréable dans sa manière d’agir. Alors qu’elle pourrait facilement se faire remettre à sa place par un ado doté de super pouvoirs.
Dès lors, ces deux saisons ne m’auront pas donné envie de m’aventurer dans les pages du comics. Son auteur étant au générique en tant que producteur, j’imagine qu’il a dû veiller à ce que cela soit conforme à son travail. Côté production, chaque épisode s’ouvre sur le logo de Playstation Originals. Quand je vois ce que Sony a fait avec un jeu vidéo comme InFamous, que l’on aperçoit d’ailleurs dans la série, je me dis qu’il aurait été plus judicieux d’en faire une adaptation vidéoludique.
JEUX VIDÉO
Marvel’s Avengers
Au cinéma, Marvel domine le game avec son univers partagé. Sauf que dans les coulisses, tout n’est pas aussi beau. En effet, dernièrement, beaucoup de professionnels du milieu ont reproché à Marvel Studios d’être le pire client en ce qui concerne les effets spéciaux. Changement de dernières minutes, délais intenables… : la qualité des CGI laisse à désirer. Pire, ces derniers semblent bâclés, et font très « jeu vidéo ». Une comparaison qui ne serait pas si dérangeante si l’on pouvait prendre en main les personnages de la firme. C’est désormais le cas avec Marvel’s Avengers.
Mais soyons honnêtes, la réputation de ce jeu vidéo n’est plus à faire. Elle est mauvaise. Pourtant, malgré cela, j’ai tout de même voulu me faire mon propre avis. Après tout, les développeurs derrière cette licence que j’adore n’étaient autres que ceux qui avaient rebooté avec succès la saga Tomb Raider. Avant de céder leur place à une autre équipe pour la fin de leur trilogie, et pouvoir s’investir dans cette fameuse adaptation des Avengers donc. Mais ça n’est pas pour autant une transposition des films, même s’il y a cet aspect cinématographique, mais bien du support d’origine: les comics.

On se retrouve donc face à une histoire originale prenant place lors du A-Day à l’Avengers Campus, comme à Disney. Ironique. Pour autant, on n’incarne pas tout de suite les Avengers, venu inaugurer leur nouveau quartier général, mais on les voit par le prisme de Kamala. J’avais découvert ce personnage lors de la série Miss Marvel qui la mettait en scène, et l’on retrouve bien l’enthousiasme qui la caractérise. En effet, lorsque l’on est fan des Avengers comme moi, on s’identifie d’autant plus facilement à sa fan attitude.
Mais les choses tournent mal et l’on prend alors le contrôle des Avengers à tour de rôle pour maitriser la situation. C’est là une sorte d’aperçu de ce qui nous attend avant de voir le récit prendre place 5 ans plus tard. Lors de cette ellipse, de la même durée qu’Endgame, les Avengers se sont séparés et il appartient à Kamala, devenue une inhumaine suite à la scène d’intro, de les réunir. La prise en main se révèle alors assez instinctive. On saute de toit en toit grâce aux pouvoirs de la jeune fille, semblables à ceux de Mister Fantastique.

Son chemin la conduira jusqu’à l’héliporteur qui deviendra le lieu central du jeu. On peut d’ailleurs s’y entrainer dans une pièce holographique digne de la salle des dangers des X-men. Mais tout aussi agréable que soit d’incarner l’élastique Kamala, elle n’est pas une Avengers. Du moins, pas encore. Or, ce jeu porte leur nom, et il le porte plutôt bien. Car lorsque vient le moment de se mettre dans la peau des membres emblématiques du groupe, les sensations sont au rendez-vous.
D’entrée de jeu, Hulk donne tout de suite le ton. Entre nos mains, le géant vert pose les bases de ce que sera le reste de l’aventure. À savoir du fun à l’état pur. En effet, on se retrouve devant un gros jeu d’arcade rentre dedans comme je les aime. La sensation de vitesse y est bien présente lors des phases de plate-forme ou de courses, pour échapper ou poursuivre un adversaire, il n’y a aucun risque lorsque l’on tombe de haut, les personnages sont rapides, leur prise en main est efficace, pour ceux qui ont des munitions, elles sont en illimitées… Bref, le plaisir de jeu est au rendez-vous.

Et cela se confirme avec les autres héros qui disposent des mêmes attributs, tout en ayant leur particularité. Dans la même lignée de force brute, on retrouve Thor. Son marteau enfonce le clou de ce gameplay jouissif, autant qu’il enfonce les ennemis de l’AIM. Le dieu du tonnerre est un véritable plaisir à manipuler. Sa puissance est parfaitement retranscrite, en plus de pouvoir faire appel au Bifrost. Il est juste dommage de ne pas voir d’interaction entre les personnages comme dans les films, notamment lorsque Thor redonne de l’énergie à Iron man.
Mais Tony Stark n’en aura pas vraiment besoin. Son armure peut être upgradée au fur et à mesure de l’aventure. D’abord avec les gants, puis les bottes… On peut même faire appel à la Hulkbuster lorsque toutes les conditions sont réunies ! Un peu plus tard, on aura même accès à une armure blanche du plus bel effet. Mais ce qui fait la spécifité d’Iron man, ce sont surtout les phases de vol. On se retrouve alors à ouvrir le feu en hauteur tout en esquivant les tirs ennemis. Par contre, si l’on vole trop haut ou que l’on s’éloigne de l’objectif, le jeu nous rappelle à l’ordre et un compte à rebours s’enclenche pour que l’on regagne la zone de combat.

En même temps, il est difficile de se réfréner tant le personnage offre une liberté assez grisante dans ses déplacements. Mais contrairement aux apparences, il ne s’agit pas là d’un jeu en monde ouvert. Même si les zones sont assez étendues, leur déroulement se révèle assez dirigiste. Chose qui n’est pas au détriment du plaisir de jeu. Ce dernier est même renouvelé puisque tous les personnages ne sont pas disponibles dès le début. Ainsi, l’arrivée tardive de Captain America permet d’avoir un gameplay plus accès sur le parkour. Avec un peu d’élan, on peut notamment courir sur les murs lorsque le vide est sous nos pieds.
Les bottes de Steve Rogers vont également rencontrer pas mal d’ennemis pour un style de combat qui rappelle fortement celui de la saga Batman Arkham. Niveau ressemblance, il est également à noter que le personnage à de faux airs de Chris Hemsworth. Bizarre, d’autant plus que la gestuelle du héros semble calqué sur celle de Chris Evans dans le MCU. À ce propos, un soin tout particulier a été accordé pour retranscrire ces mouvements par rapport à ce que l’on peut voir dans les films. On s’y croirait vraiment lorsque l’on voit certaines postures s’émanciper des cases des comics.

Et s’il y en a bien une qui aurait dû rester dedans, c’est bien Black Widow. Bien qu’elle puisse devenir invisible, son personnage est un défaut du jeu à part entière. En plus de certains ralentissements qui, comme par hasard, sont plus fréquents lorsque l’on prend les commandes de la veuve noire. En effet, après avoir pris le contrôle des autres Avengers, son gameplay se révèle beaucoup trop classique. J’aurais volontiers échangé ce personnage contre n’importe quel autre du catalogue de l’univers Marvel. Je pense notamment à Wolverine ou plus globalement aux X-men, voir même à Blade.
Doctor Strange aurait également été un choix judicieux. D’autant plus que la catégorie des sorciers n’est pas représentée, comparer aux mutants, inhumains, extraterrestres, humains… Mais bon, sans doute que le personnage est trop cheaté pour pouvoir l’inclure dans le roster de base. Surtout lorsque l’on voit de quoi il est capable dans Infinity War, même si son film solo a montré qu’il pouvait y avoir de sacrés passages de plate-forme dans la dimension miroir. Cette frustration est encore pire au regard des personnages présents dans le jeu, mais seulement à titre de caméo.
C’est notamment le cas pour Ant-man. Ainsi, l’homme fourmi est relégué au second plan alors qu’il aurait été cool de pouvoir grandir à volonté lorsque l’on a une jauge complète, ou de rapetisser à un niveau microscopique pour surprendre les adversaires. En tout cas, les héros que j’ai cités auraient pu faire l’objet d’un DLC, chose qu’ont obtenu Black Panther, Kate Bishop et Hawkeye. Si le jeu avait eu plus de succès, il en aurait peut-être été ainsi. En l’état, Marvel’s Avengers reste incroyable. Je ne comprends vraiment le bashing dont il a été victime. Peut-être parce que j’arrive après la bataille et que j’ai tout le contenu disponible pour pouvoir en profiter ?

Je l’ignore. Une chose est sûre: même si cela n’a pas abouti à une saga Avengers, voir même à un univers partagé vidéoludique, je suis bien content que cette équipe de développement n’ait pas terminé sa trilogie Tomb Raider pour apposer son savoir-faire à cette franchise.